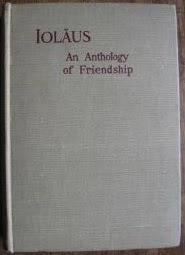FOLIO 2235
ou
LES VICISSITUDES DE CORYDON
« Il ne faut parler que si l'on ne peut se taire ; et ne parler que de ce que l'on a surmonté, — tout le reste est bavardage, " littérature ", manque de discipline. ». (Nietzsche, Humain, trop humain, 2, Préface de 1886, § 1.
Corydon fut réédité par les éditions Gallimard (Paris VIIe) en collection de poche Folio, n° 2235, en février 1991, puis réimprimé en septembre 2001, mars 2012 et mai 2024. Ces tirages de 2001, 2012 et 2024, plus corrects que celui de 1991, comportaient encore quelques erreurs anciennes, et des erreurs nouvelles …. Page 3 : il convient de rétablir le sous-titre fondamental " Quatre dialogues socratiques " ; page 8, lire " troisième " au lieu du barbarisme "troisixème"... ; page 48, dans la note, lire " t. II, pp. 48-49 " au lieu de " t. II, p. 28 "; page 88, dans la note, lire " abundance upon " au lieu de " abundance on "; page 93, lire " linéairement " au lieu de " linérairement "; page 125, lire " l’Antiquité " au lieu de " l’antiquité ".
En 1947, accordant à André Gide le Prix Nobel de Littérature, l'Académie royale de Suède dit récompenser aussi l'intrépide " amour de la vérité " qui engendra Corydon, " dialogues socratiques " qui étaient, aux yeux de Gide, " le plus important " de ses livres (Journal, 19 octobre 1942 et janvier 1946), qu'on ne comprendrait que " plus tard " (Journal, 8 juillet 1930 ; 19 février 1942), et dont le simple projet lui donnait " le sentiment de l'indispensable " (Journal, 12 juillet 1910). Il affirma avoir travaillé sur ce petit livre, de 1909 à 1922, " plus âprement et durant plus longtemps qu'aucun autre " (Journal, 18 décembre 1946) ; « Il n'y a pas pour moi d'entraînement (vers ce livre). Il est certain que je l'écris hors de saison et quand je n'ai plus besoin de l'écrire. [...] La difficulté vient précisément de ceci que je dois artificiellement réactualiser un problème auquel j'ai donné (pour ma part) une solution pratique, de sorte que, à vrai dire, il ne me tourmente plus. » (Journal, " Feuillets ", 1918) ; « J'ai longtemps attendu. Je voulais être sûr que ce que j'avançais dans Corydon, qui me semblait aventuré peut-être, je n'allais pas devoir le renier bientôt. » (Journal, 13 août 1922) ; « J’ai longtemps attendu pour écrire ce livre, et, l’ayant écrit, pour l’imprimer. Je voulais être sûr que ce que j'avançais dans Corydon, et qui me paraissait évident, je n'allais pas avoir bientôt à m’en dédire. Mais non : ma pensée n’a fait ici que s’affermir, et ce que je reproche à présent à mon livre, c’est sa réserve et sa timidité. » (Préface à l'édition Nrf/Gallimard de 1924, datée novembre 1922).
Ma perspective n'est pas d'étudier Corydon comme œuvre littéraire Cela fut fait, inter alii, par Daniel Moutote (1916-1998), Claude Martin, Dominique Fernandez, Eva Ahlstedt, Dr Patrick Pollard et Monique Nemer ; Alain Goulet (1940-2018), auteur des articles " Corydon " et " Homosexualité " du Dictionnaire Gide, éditeur de Corydon dans André Gide, Romans et récits, tome II, Paris : Gallimard, 2009, collection " Bibliothèque de la Pléiade ", avait publié Les Corydon d'André Gide (Paris : Orizons/L'Harmattan, avril 2014). J'examine la situation et l'intérêt de ces dialogues en relation avec la vie personnelle d'André Gide, et dans le cadre de l'âpre discussion, développée depuis l'Antiquité grecque et souvent à caractère philosophique, autour des questions homosexuelle et pédérastique (questions amalgamées à tort à celle de la pédophilie par les médias d'aujourd'hui ; Gide n'avait jamais protesté contre le seuil de consentement de 13 ans en vigueur à son époque de 1863 à 1942).
Corydon n'était pas la première étude de la question, ni même la première étude française, loin de là ; Montaigne, auquel Gide consacra une étude remarquée (Essai sur Montaigne, 1929), l'avait abordée, et l'on trouve une soixantaine de passages sur l'amour grec dans les Essais ; j'en ai fait un inventaire détaillé et annoté. Des textes brefs, mais incisifs, figurent dans certains recueils manuscrits des XVIIe et XVIIIe siècles ; le philosophe libertin La Mothe Le Vayer publia anonymement en 1630 ses curieuses et intelligentes réflexions sur le sujet (données dès 1985 en appendice à la première version de mon Dictionnaire de l'homosexualité masculine). Une brève mais audacieuse histoire de l'amour, y compris l'amour masculin, figure dans un Recueil de pièces choisies de 1735 : il s'agit de l'Ode à Priape du chansonnier et écrivain Alexis Piron (écrite vers 1710), pages 17-22 ; plus topique, la " Chanson " des pages 74-75 dont l'incipit (Bardaches jeunes et dodus,/Beaux enfants de Sodome,/Soyez ici les bienvenus) donne une idée de la suite. Voltaire, notamment avec son article "Amour socratique " dans les Questions sur l'Encyclopédie (1771-1775 ; développement de l'article " Amour nommé socratique " du Dictionnaire philosophique de 1764), l'helléniste Pierre-Henri Larcher, le philosophe Jacques-André Naigeon, le marquis de Sade (notamment dans Français, encore un effort ... mais aussi ailleurs), Étienne Pivert de Sénancour (De l'Amour..., extraits également donnés en appendice à mon Dictionnaire..., Julien-Joseph Virey (De la femme sous les rapports physiologique, moral et littéraire, 1825, Dissertation sur le libertinage et ses dangers, article III, " Du libertinage, et de ses diverses formes chez les Grecs et les Romains ", pages 344-358), Georges Hérelle et quelques autres eurent le mérite de se documenter et de réfléchir assez sérieusement sur la question, bien plus sérieusement en tout cas que Boucher d'Argis, auteur du décevant, car peu éclairé et sans originalité, article "Sodomie" dans L'Encyclopédie (1765).
Corydon n'était pas la première étude de la question, ni même la première étude française, loin de là ; Montaigne, auquel Gide consacra une étude remarquée (Essai sur Montaigne, 1929), l'avait abordée, et l'on trouve une soixantaine de passages sur l'amour grec dans les Essais ; j'en ai fait un inventaire détaillé et annoté. Des textes brefs, mais incisifs, figurent dans certains recueils manuscrits des XVIIe et XVIIIe siècles ; le philosophe libertin La Mothe Le Vayer publia anonymement en 1630 ses curieuses et intelligentes réflexions sur le sujet (données dès 1985 en appendice à la première version de mon Dictionnaire de l'homosexualité masculine). Une brève mais audacieuse histoire de l'amour, y compris l'amour masculin, figure dans un Recueil de pièces choisies de 1735 : il s'agit de l'Ode à Priape du chansonnier et écrivain Alexis Piron (écrite vers 1710), pages 17-22 ; plus topique, la " Chanson " des pages 74-75 dont l'incipit (Bardaches jeunes et dodus,/Beaux enfants de Sodome,/Soyez ici les bienvenus) donne une idée de la suite. Voltaire, notamment avec son article "Amour socratique " dans les Questions sur l'Encyclopédie (1771-1775 ; développement de l'article " Amour nommé socratique " du Dictionnaire philosophique de 1764), l'helléniste Pierre-Henri Larcher, le philosophe Jacques-André Naigeon, le marquis de Sade (notamment dans Français, encore un effort ... mais aussi ailleurs), Étienne Pivert de Sénancour (De l'Amour..., extraits également donnés en appendice à mon Dictionnaire..., Julien-Joseph Virey (De la femme sous les rapports physiologique, moral et littéraire, 1825, Dissertation sur le libertinage et ses dangers, article III, " Du libertinage, et de ses diverses formes chez les Grecs et les Romains ", pages 344-358), Georges Hérelle et quelques autres eurent le mérite de se documenter et de réfléchir assez sérieusement sur la question, bien plus sérieusement en tout cas que Boucher d'Argis, auteur du décevant, car peu éclairé et sans originalité, article "Sodomie" dans L'Encyclopédie (1765).
Corydon fit semblant d'ignorer à peu près tout ce qui l'avait précédé de peu ou de loin dans son entreprise, notamment en Angleterre ; Alan Sheridan le décrivit comme “ the first serious attempt by a homosexual to defend the practice of homosexuality to the general public ” (André Gide : A Life in the Present, London : Hamish Hamilton, 1998, page 626). Si Gide mentionne en passant le sexologue Havelock Ellis et cite une fois (pages 111-112) le poète et critique littéraire John Addington Symonds, il masque les nombreux emprunts faits à l'édition de 1915 de l’Anthologie d’Edward Carpenter
Third Edition, 1929,
George Allen et Unwin, London.
et au Livre d'Amour des Anciens (1911), collection Les Maîtres de l'Amour de la Bibliothèque des Curieux :
Gide s'avouera plus tard, en revanche, comme le porteur d'une multiplicité de significations subjectives : " gage d'une délivrance " survenue depuis longtemps (Journal, 29 décembre 1932), livre écrit " hors de saison ", voulu utile à d'autres : " qui dira le nombre de ceux que ce petit livre a, du même coup, délivrés ? " (Journal, 29 décembre 1932) ; précaution jugée utile contre toute " mascarade posthume " (Note manuscrite, dossier Corydon, bibliothèque Jacques Doucet, Paris Ve, γ 885), telle que celle déplorée en juin 1907 après lecture de la biographie édulcorée de Paul Verlaine par Edmond Lepelletier (Paul Verlaine Sa Vie - Son Œuvre, Paris : Société du Mercure de France, 1907). « Ce qui me le fit entreprendre, d’abord, ou m’en donna quelque première idée : le désaveu de cette fausse sainteté dont mon dédain de la tentation ordinaire me revêtait » (Journal, " Feuillets ", 1918-1919) ; sur ce sens insolite d'ordinaire, voir l’entrée correspondante de mon Dictionnaire français de l'homosexualité masculine.
La préface dite " Préface de la seconde édition (1920) ", confirme que ce furent à la fois une exigence intellectuelle de vérité et une exigence morale de probité, d’honnêteté intellectuelle, et non quelque chose de l’ordre de l’actuel slogan politique d' " égalité des droits pour tous " du mouvement LGBTQ+ (mariage, adoption, PMA et GPA) — qui animaient alors l’auteur de Corydon :
« Je me décide après huit ans d'attente à réimprimer ce petit livre. Il parut en 1911, tiré à douze exemplaires, lesquels furent remisé dans un tiroir — d'où ils ne sont pas encore sortis.
Le Corydon ne comprenait alors que les deux premiers dialogues, et le premier tiers du troisième. Le reste du livre n'était qu'ébauché. Des amis me dissuadaient d'achever de l'écrire. « Les amis, dit Ibsen, sont dangereux non point tant par ce qu'ils vous font faire, que parce qu'ils vous empêchent de faire. » Les considérations que j'exposais dans ce petit livre me paraissaient pourtant des plus importantes, et je tenais pour nécessaire de les présenter. Mais j'étais d'autre part très soucieux du bien public, et prêt à celer ma pensée dès que je croyais qu'elle pût troubler le bon ordre. C'est bien aussi pourquoi, plutôt que par prudence personnelle, je serrai Corydon dans un tiroir et l'y étouffai si longtemps. Ces derniers mois néanmoins je me persuadai que ce petit livre, pour subversif qu'il fût en apparence, ne combattait après tout que le mensonge, et que rien n'est plus malsain au contraire, pour l'individu et pour la société, que le mensonge accrédité.
Ce que j’en dis ici, après tout, pensais-je, ne fais point que tout cela soit. Cela est. Je tâche d’expliquer ce qui est. Et puisque l’on ne veut point, à l’ordinaire, admettre que cela est, j’examine, je tâche d’examiner, s’il est vraiment aussi déplorable qu’on le dit – que cela soit. » (page 11 ; les références de pages dans le présent article renvoient à l'édition Gallimard/Folio).
L'entreprise de publication fut retardée d’abord sous l'influence de son beau-frère et ami l'écrivain Marcel Drouin, puis par respect pour l'épouse d'un mariage abstrait (Gide n’ayant jamais envisagé une publication sous pseudonyme). Quelques amis ou relations attirèrent son attention sur les inconvénients possibles d’une telle publication ; on trouvera le détail de ces mises en garde dans l’essai de Monique Nemer, Corydon citoyen. Essai sur André Gide et l'homosexualité, Paris : Gallimard, 2006, collection blanche, chapitre III.
Madeleine, qui résidait alors à Cuverville-en-Caux (Seine-Maritime), détruisit toutes les lettres reçues de son mari après qu'il ait fait, pendant l’été 1918, un long séjour en Angleterre avec son faux neveu, le futur réalisateur de films cinématographiques Marc Allegret (1900/1973). André Gide, d'abord profondément abattu et meurtri par cette destruction, se sentit ensuite libéré : « À présent rien ne me retient plus de publier durant ma vie et Corydon et les Mémoires [publiés en 1925 sous le titre Si le grain ne meurt] » (Journal, 24 novembre 1918). Les Cahiers de la Petite Dame — rédigés en long secret par Maria van Rysselberghe, amie et voisine de Gide au 1 bis rue Vaneau (Paris, VIIe arrondissement), puis grand-mère de Catherine Gide — suivent au jour le jour les hésitations tenaces de l'auteur de Corydon, sa crainte de compromettre le jeune Marc. En novembre 1919, André Gide écrivit à son amie anglaise Dorothy Bussy : « La partie que je m'apprête à jouer est si dangereuse que je ne la puis gagner sans doute qu'en me perdant moi-même » ; le 30 janvier 1920, dramatisant un peu, il annonçait « deux livres (...) dont l'un est de nature à me faire ficher en prison » ; en avril 1921, il envisageait de solliciter Sigmund Freud pour une préface à une éventuelle traduction allemande. Une dernière offensive, celle du philosophe thomiste Jacques Maritain (1882-1973) en décembre 1923, rencontra un refus poli mais ferme de renoncer à la publication (Journal, 21 décembre 1923). La Petite Dame, du " côté de Vaneau ", accepta facilement cette publication qui provoqua quelque gêne du " côté de Cuverville ". Comme le héros de la Recherche, Gide avait ses côtés ...
Madeleine, qui résidait alors à Cuverville-en-Caux (Seine-Maritime), détruisit toutes les lettres reçues de son mari après qu'il ait fait, pendant l’été 1918, un long séjour en Angleterre avec son faux neveu, le futur réalisateur de films cinématographiques Marc Allegret (1900/1973). André Gide, d'abord profondément abattu et meurtri par cette destruction, se sentit ensuite libéré : « À présent rien ne me retient plus de publier durant ma vie et Corydon et les Mémoires [publiés en 1925 sous le titre Si le grain ne meurt] » (Journal, 24 novembre 1918). Les Cahiers de la Petite Dame — rédigés en long secret par Maria van Rysselberghe, amie et voisine de Gide au 1 bis rue Vaneau (Paris, VIIe arrondissement), puis grand-mère de Catherine Gide — suivent au jour le jour les hésitations tenaces de l'auteur de Corydon, sa crainte de compromettre le jeune Marc. En novembre 1919, André Gide écrivit à son amie anglaise Dorothy Bussy : « La partie que je m'apprête à jouer est si dangereuse que je ne la puis gagner sans doute qu'en me perdant moi-même » ; le 30 janvier 1920, dramatisant un peu, il annonçait « deux livres (...) dont l'un est de nature à me faire ficher en prison » ; en avril 1921, il envisageait de solliciter Sigmund Freud pour une préface à une éventuelle traduction allemande. Une dernière offensive, celle du philosophe thomiste Jacques Maritain (1882-1973) en décembre 1923, rencontra un refus poli mais ferme de renoncer à la publication (Journal, 21 décembre 1923). La Petite Dame, du " côté de Vaneau ", accepta facilement cette publication qui provoqua quelque gêne du " côté de Cuverville ". Comme le héros de la Recherche, Gide avait ses côtés ...
Imprimé début janvier 1924, le " terrible livre " (lettre à l'ami Henri Ghéon, 5 juillet 1910) fut mis en vente en mai ; afin d’éviter de donner prise à une possible accusation de prosélytisme, les exemplaires furent placés en librairie sans aucun service de presse ; quelques intimes avaient déjà eu connaissance de la version dactylographiée en huit exemplaires de 1909 ; voir les lettres à Jacques Copeau, 6 et 8 août 1909 : « Mon livre sera achevé avant l'hiver [...] La moitié en est écrite : id est : déjà dactylographiée à 8 exemplaires. J'ai mené ce travail exactement au point que je voulais le mener avant de partir en vacances. [...] Qu'il me tarde de vous faire connaître ce livre. » Connaissance aussi de la deuxième version C. R. D. N., tirée à 12 exemplaires en mai 1911 ; version manifestement (délibérément ?) inachevée - d'où, très probablement, l'explication du titre lacunaire – ainsi que de la troisième version de mars 1920, tirée à 21 ou 22 exemplaires. Cahiers de la Petite Dame : « Je lui remets une copie que je fis de C.R.D.N., avec les corrections et les ajoutés ; décidément, la typographie de ce titre l'enchante, la symétrie des trois voyelles qui s'y inscrivent et qu'il supprime, O Y O, le ravit. Je lis rapidement, tandis qu'il suit sur son texte ; à ma grande confusion, il y a pas mal d'erreurs. » (CPD, tome 1, page 7). Aucune de ces trois productions (1909, 1911 et 1920), genre que les Anglais désignent fort justement par l'expression private printing, ne mérite donc la qualification, pourtant constamment répétée (y compris dans la mention « PRÉFACE DE LA SECONDE ÉDITION (1920) », page 11 …), d'édition ou de publication ; en revanche, l'édition de 1924 n'était pas (cela fut dit) une " publication anonyme " (sans doute par confusion avec le Livre blanc, 1928, attribué à Jean Cocteau).
L'abord de ces dialogues est ardu, en partie à cause de l'emploi des termes d'origine allemande aujourd’hui oubliés uranien, uraniste et uranisme ; Urning, est un néologisme dû à Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895) dans les années 1860 et promu dans le but de renouer avec le platonisme ; en 1927, l’écrivain François Porché trouvait déjà ces mots " un peu désuets ". Mais la forme et le contenu de ce petit livre étaient " inactuels " dès sa parution, ceci résultant du choix délibéré de matériaux anciens, comme s’il s’agissait de monter un dossier à l’intention d’un contradicteur du XIXe siècle ; c’était bien le cas, comme on verra plus loin ; l'article du Spectator, cité en anglais (III, ii, page 88), date de ... 1712. André Gide assembla soigneusement des éléments de l'histoire universelle et de la Weltliteratur, tout en faisant l'économie de certaines références majeures ; Goethe est " convoqué " ; mais David Hume, Voltaire et Diderot sont absents, non dépourvus pourtant de titres à citations ; Gide déplore dans la société française cette French gallantry évoquée par David Hume dans Inquiry into the Principles of Morals, " A Dialogue ", précisément en opposition à l'amour grec.
« Again, to cast your eye on the picture which I have drawn of modern manners; there is almost as great difficulty, I acknowledge, to justify French as Greek gallantry; except only, that the former is much more natural and agreeable than the latter. [...] The Greek loves, I care not to examine more particularly. I shall only observe, that, however blameable, they arose from a very innocent cause, the frequency of the gymnastic exercises among that people; and were recommended, though absurdly, as the source of friendship, sympathy, mutual attachment, and fidelity ; qualities esteemed in all nations and all ages. »Le Banquet de Platon est évoqué, pas le commentaire indulgent qu'en fit Jean Racine : " Apologie de l'amour des garçons (...) Amour des jeunes gens : pour engendrer de beaux discours. " (Racine, Prose, Paris : Gallimard, 1966, collection " Bibliothèque de la Pléiade ", pages 898-899). Reste que Gide démontra magnifiquement que sur le plan culturel, l'homosexualité et sa composante pédérastique, en tant qu'objet d'étude, de discussion ou en tant que thème littéraire, ne sont en aucune façon marginales ou négligeables ; sa démonstration fut reprise par Roger Peyrefitte dans son roman Notre Amour (Paris : Flammarion, 1967). Se considérant en quelque sorte " hors du temps " quant à l'origine, la validité et la réception de ses arguments, André Gide était convaincu que the book could wait, pouvait attendre ses lecteurs qualifiés (préface à la première édition américaine, 1949), lecteurs qu'il trouva.
Les échanges entre le Dr Corydon et son Interviewer (auquel il laissera le mot de la fin) sont commentés à la première personne par ce dernier. Cette forme dialoguée fut souvent adoptée pour traiter ce thème, notamment par Plutarque, dont on verra plus loin l'importance ; elle est adaptée aux sujets délicats ou qui prêtent à polémiques, lorsque l'on a, comme l'homme probe qu'était Gide, l'élémentaire souci de l'objectivité ; enfin, elle satisfaisait le goût de l'auteur pour les " Interviews imaginaires ". Gide, par la voix du Visiteur, se fait l’avocat du diable, et on ne peut dire qu’il fasse avec cette œuvre un coming out stricto sensu, encore moins un coming out civique. On a plutôt l’impression d’une concession faite à Wilde et Proust, qui lui recommandèrent de ne jamais dire « je ». Cette distance est par ailleurs justifiée par le fait qu’à la date de la publication de Corydon Gide était marié et père d’une fille, conçue en juillet 1922 avec Élisabeth Van Rhysselberghe. Difficile dans ces conditions de parler d’une « exigeante profération d’un " Je " » ; ce qu'osa pourtant Monique Nemer dans son Corydon citoyen. Essai sur André Gide et l'homosexualité (Paris : Gallimard, 2006, collection " blanche ", page 29) ; mais un peu plus loin (page 113), elle s’interrogeait : « Est-il, dans ces conditions [cette répartition entre un " il " qui développe l’argumentation et un " je " qui, en feignant de la contester, lui permet de l’approfondir], légitime de parler de coming out ? ». Louable, bien que tardive, interrogation ... Seule la préface datée novembre 1922 laisse entendre, comme clé des dialogues, que Gide soutient les thèses du Dr Coydon , une autre clé étant Si le grain ne meurt, véritable coming out, lui.
Qu'un médecin expose les thèses de Gide et se présente comme un " pédéraste normal ", voilà un pied de nez à la médecine sexologique de l'époque et à toute la médecine légale et psychiatrique du XIXe siècle, depuis Paul A. O. Mahon (1752-1801), Médecine légale et police médicale (1801). La pertinence des injonctions religieuses est récusée, implicitement, par absence de toute référence aux condamnations et stigmatisations bibliques, explicitement en même temps que l’est un « mysticisme scientifique » :
« À vrai dire je me méfie de cette " voix de la nature" . Chasser Dieu de la création et le remplacer par des voix, la belle avance ! Cette éloquente Nature m'a tout l'air d'être celle qui avait " horreur du vide ". Cette sorte de mysticisme scientifique me paraît bien autrement néfaste à la science que la religion ... N'importe ! Prenons le mot " voix " dans son sens le plus métaphorique, encore nierai-je que cette voix dise au mâle féconde, qu'elle dise à la femelle : choisis. Elle dit, à l'un comme à l'autre sexe : " jouis ", simplement ; c'est la voix de la glande qui demande qu'on l'exonère, des organes qui réclament emploi — organes qui sont bien conformés selon ce que leur précise fonction exige, mais que le seul besoin de volupté guidera. Rien de plus. » (II, iv, p. 55) ; « Il y a peut-être un Dieu ; il n’y a pas d’intention dans la Nature ; je veux dire que, s'il y a intention, elle ne peut être que de Dieu. » (II, v, p. 61)
Gide avait un temps envisagé une autre formule : « un Corydon tout différent, grave (...) un dialogue avec mon père [Paul] » : « Je citerais (j'eusse cité) la page de son livre par où il me condamne, et lui dirais : " Condamnez-moi comme Saül fit Jonathan [Voir, dans l’Ancien Testament, I et II Samuel ; allusion implicite à l’amitié passionnée entre David et Jonathan] après que son fils eut mangé contre sa défense ; de vous mon père j'accepte la condamnation ; mais je ne l'accepterai point de ceux-là qui m'offriront, en place de mon péché, adultère, séduction ou débauche. » (Manuscrit γ 885, Bibliothèque Jacques Doucet, Paris).
On aimerait savoir à quel âge André Gide découvrit, avec la stupeur que l'on imagine, l'accumulation de qualificatifs fortement péjoratifs (sans nom, infâme, odieux, honte, corruption, dégénérés, horreur, décadence, honteux, vice) dans ces quelques lignes écrites par son père, Paul Gide (1832-1880) :
« Un amour sans nom, ou plutôt un vice infâme, était honoré dans toute la Grèce comme une vertu. [...] il me répugne de citer les textes et de m'arrêter sur un sujet si odieux. Il faut le dire à la honte de la Grèce : sa corruption était telle que les Romains, tout dégénérés qu'ils étaient eux-mêmes, en eurent horreur ; jamais, même au plus bas degré de leur décadence ils n'arrivèrent à méconnaître à ce point les sentiments de la nature ; s'ils s'abandonnèrent, eux aussi, au plus honteux des vices, du moins ce ne fut pas avec l'assentiment et les louanges de leurs philosophes et de leurs législateurs. » La Condition de la femme dans l'Antiquité, 1867, réédité en 1885, chapitre III, " Grèce ", pages 76-77 de l'édition de 1867, pages 70-71 de l'édition de 1885 ; Paul Gide fut professeur agrégé de droit romain à la Faculté de droit de Paris-Panthéon.
Paul Gide poursuivait en attribuant à la pédérastie l'infériorisation de la femme. Ceci explique, tout autant que le souci d'histoire universelle, l'ancienneté des sources et références ; André Gide aurait évidemment souhaité avoir pu rectifier le jugement que son père avait hâtivement formulé en 1867, et maintenu dans l’édition posthume de 1885 ; la première date n'est pas anodine : la demi-décennie 1866-1870 ayant vu, avec les publications de Karl Heinrich Ulrichs et de Karl Maria Benkert (dit Kertbeny), la naissance de l'argumentation du mouvement homosexuel moderne, la création des termes allemands Homosexualität et Urning (qui donna en français uraniste), ainsi que la première expression de l'opposition politique (communiste) à ce mouvement ; voir la lettre de Friedrich Engels à Karl Marx, 22 juin 1869, où il reprochait à Ulrichs de transformer la cochonnerie en théorie avec ses droits du cul (en français dans le texte).
André Gide souhaita aussi répondre à ces lignes de Remy de Gourmont (1858-1915), voire à l'article tout entier (article reproduit dans l'entrée uranisme de mon DFHM) :
« M. DESMAISONS. — L'uranisme répugne à ma sensibilité, mais mon intelligence peut le considérer avec intérêt. C'est un refus de soumission qui étonne et fait réfléchir. Mais je le voudrais plus franc. Les sujets de cette passion avouent trop, par leur attitude contrainte, qu'ils sentent, quand on les démasque, toute la honte de leur conduite. Quand on n'a pas le cœur d'être cynique, il faut être normal. Ceux-là méritent d'être punis les premiers qui avouent humblement leur faute. » " Dialogue des amateurs L. — L'amour à l'envers ", Mercure de France, 1er décembre 1907, pages 474-477.
Les autres éléments d'actualité ou de passé proche sont assez rares. Les magnifiques poèmes engagés, véritable coming out, de Paul Verlaine dans l’hebdomadaire La Cravache parisienne, le 29 septembre 1888 et le 2 février 1889, repris dans Parallèlement, ainsi que ceux, remarquables, d’Hombres, ne sont pas mentionnés :
« Tout, la jeunesse, l'amitié,/Et dans nos cœurs, ah ! que dégagés/Des femmes prises en pitié/Et du dernier des préjugés, […] Scandaleux sans savoir pourquoi,/(Peut-être que c'était trop beau)/Mais notre couple restait coi/Comme deux bons porte-drapeau. » (Laeti et errabundi).
« Ces passions qu’eux seuls nomment encore amours […] Ah ! les pauvres amours banales, animales, normales ! […] ce combat pour l’affranchissement de la lourde nature ! » (Ces passions …)
« Nous encaguions ces cons avec leur air bonasse,
Leurs normales amours et leur morale en toc, »
Hombres, XI.
Les romans à thème homosexuel de Rachilde, Lucien Daudet, Georges Eekhoud ou Achille Essebac, la revue mensuelle de Jacques Fersen (Akademos, publiée de janvier à décembre 1909) et l'article fondamental de Guy Debrouze qui y parut en juillet, " Le préjugé contre les mœurs ", sont également passés sous silence.
Corydon vient du grec Κορύδων, nom de berger dans la quatrième des Idylles de Théocrite de Syracuse. Est nommé Corydon le berger amoureux d'Alexis dans la deuxième des dix églogues de Virgile : Formosum pastor Corydon ardebat Alexim, églogue qui fut la première à avoir été traduite en français, par Loïs Grandin, dès 1543, l’année de la mort de Copernic. Derrière Alexis, se cache un Alexandre aimé de Virgile lui-même selon le grammairien ancien Donat. Gide avait lu cette bucolique au printemps 1891, à 22 ans donc, et il l'avait même apprise par cœur ; cf Jacques Cotnam (1941-2010), " Le « Subjectif » d'André Gide" , Cahiers André Gide 1, Paris : Gallimard, 1969, pages 41, 61 et 106.
Pierre de Ronsard écrivit une " Odelette à Corydon " (un de ses serviteurs) . Gide connaissait également la petite comédie de Verlaine " Les Uns et les autres " (dans Jadis et Naguère, 1885) dont Corydon et Aminte sont deux personnages très secondaires.
Pierre de Ronsard écrivit une " Odelette à Corydon " (un de ses serviteurs) . Gide connaissait également la petite comédie de Verlaine " Les Uns et les autres " (dans Jadis et Naguère, 1885) dont Corydon et Aminte sont deux personnages très secondaires.
Le sous-titre de Corydon, Quatre dialogues socratiques, porte une triple connotation, philosophique, érotique et pédagogique, qui s'est malheureusement perdu dans les dernières réimpressions ... (notamment en collection Folio) ; l'ensemble, titre plus sous-titre, fixait un cadre de référence, celui du socle gréco-latin de notre culture occidentale incarnée notamment par Platon et Virgile.
La préface, datée de novembre 1922, expliquait le retard à la publication par une crainte, en fait celle de peiner sa femme-cousine Madeleine :
« Je n’ai jamais cherché de plaire au public ; mais je tiens excessivement à l’opinion de quelques uns ; c’est affaire de sentiments et rien ne peut contre cela. Ce que l’on a pris parfois pour une certaine timidité de pensée n’était le plus souvent que la crainte de contrister ces quelques personnes ; de contrister une âme, en particulier, qui de tout temps me fut chère entre toutes. ». Éclairage ultérieur ; « " Il ne faut contrister personne" (" aucune âme ", disait poétiquement [Maurice] Barrès). Ériger en maximes ces formules veules, se peut-il imaginer rien de plus débilitant ? » Journal, 7 octobre 1931.
PREMIER DIALOGUE
PRÉFACE [novembre 1922, pages 7-9]
Mes amis me répètent que ce petit livre est de nature à me faire le plus grand tort. Je ne pense pas qu'il puisse me ravir aucune chose à quoi je tienne ; ou mieux : je ne crois pas tenir beaucoup à rien de ce qu'il m'enlèvera : applaudissements, décorations, honneurs, entrées dans les salons à la mode, je ne les ai jamais recherchés. Je ne tiens qu'à l'estime de quelques rares esprits, qui, je l'espère, comprendront que je ne l'ai jamais mieux méritée qu'en écrivant ce livre et qu'en osant aujourd'hui le publier. Cette estime, je souhaite de ne pas la perdre ; mais certainement, je préfère la perdre que la devoir à un mensonge, ou à quelque malentendu.
Je n'ai jamais cherché de plaire au public ; mais je tiens excessivement à l'opinion de quelques uns ; c'est affaire de sentiment et rien ne peut contre cela. Ce que l'on a pris parfois pour une certaine timidité de pensée, n'était le plus souvent que la crainte de contrister ces quelques personnes ; de contrister une âme, en particulier, qui de tout temps me fut chère entre toutes. Qui dira de combien d'arrêts, de réticences et de détours est responsable la sympathie, la tendresse ? — Pour ce qui est des simples retards, je ne puis les tenir pour regrettables, estimant que les artistes de notre temps pèchent le plus souvent par grand défaut de patience. Ce que l'on nous sert aujourd'hui eût souvent gagné à mûrir. Telle pensée qui d'abord nous occupe et nous paraît éblouissante, n'attend que demain pour flétrir. C'est pourquoi j'ai longtemps attendu pour écrire ce livre, et l'ayant écrit, pour l'imprimer. Je voulais être sûr que ce que j'avançais dans Corydon, et qui me paraissait évident, je n'allais pas avoir bientôt à m'en dédire. Mais non : ma pensée n'a fait ici que s'affermir, et ce que je reproche à présent à mon livre, c'est sa réserve et sa timidité. Depuis plus de dix ans qu'il est écrit, exemples, arguments nouveaux, témoignages, sont venus corroborer mes théories. Ce que je pensais avant la guerre, je le pense plus fort aujourd'hui. L'indignation que Corydon pourra provoquer, ne m'empêchera pas de croire que les choses que je dis ici doivent être dites. Non que j'estime que tout ce que l'on pense doive être dit, et dit n'importe quand, — mais bien ceci précisément, et qu'il faut le dire aujourd'hui ! (1)
Certains amis, à qui j'avais d'abord soumis ce livre, estiment que je m'y occupe trop des questions d'histoire naturelle — encore que je n'aie point tort, sans doute, de leur accorder tant d'importance ; mais, disent-ils, ces questions fatigueront et rebuteront les lecteurs. — Eh parbleu ! c'est bien ce que j'espère : je n'écris pas pour amuser et prétends décevoir dès le seuil ceux qui chercheront ici du plaisir, de l'art, de l'esprit ou quoi que ce soit d'autre enfin que l'expression la plus simple d'une pensée très sérieuse. —
Encore ceci :
Je ne crois nullement que le dernier mot de la sagesse soit de s'abandonner à la nature, et de laisser libre cours aux instincts ; mais je crois qu'avant de chercher à les réduire et domestiquer, il importe de bien les comprendre — car nombre des disharmonies dont nous avons à souffrir ne sont qu'apparentes et dues uniquement à des erreurs d'interprétations.
Nov. 1922.
1. Certains livres — ceux de Proust en particulier — ont habitué le public à s'effaroucher moins et à considérer de sang-froid ce qu'il feignait d'ignorer, ou préférait ignorer d'abord. Nombre d'esprits se figurent volontiers qu'ils suppriment ce qu'ils ignorent ... Mais ces livres, du même coup, ont beaucoup contribué, je le crains, à égarer l'opinion. La théorie de l'homme-femme, des " Sexuelle Zwischenstufen " (degrés intermédiaires de la sexualité) que lançait le Dr Hirschfeld en Allemagne, assez longtemps déjà avant la guerre, et à laquelle Proust semble se ranger — peut bien n'être point fausse ; mais elle n'explique et ne concerne que certains cas d'homosexualité, ceux précisément dont je ne m'occupe pas dans ce livre — les cas d'inversion, d'efféminement, de sodomie. Et je vois bien aujourd'hui qu'un des grands défauts de mon livre est précisément de ne point m'occuper d'eux — qui se découvrent être beaucoup plus fréquents que je ne le croyais d'abord.
Et mettons que, ceux-ci, la théorie de Hirschfeld les satisfasse. Cette théorie du " troisième sexe " ne saurait aucunement expliquer ce qu'on a coutume d'appeler " l'amour grec ": la pédérastie — qui ne comporte efféminement aucun, de part ni d'autre.
Mes amis me répètent que ce petit livre est de nature à me faire le plus grand tort. Je ne pense pas qu'il puisse me ravir aucune chose à quoi je tienne ; ou mieux : je ne crois pas tenir beaucoup à rien de ce qu'il m'enlèvera : applaudissements, décorations, honneurs, entrées dans les salons à la mode, je ne les ai jamais recherchés. Je ne tiens qu'à l'estime de quelques rares esprits, qui, je l'espère, comprendront que je ne l'ai jamais mieux méritée qu'en écrivant ce livre et qu'en osant aujourd'hui le publier. Cette estime, je souhaite de ne pas la perdre ; mais certainement, je préfère la perdre que la devoir à un mensonge, ou à quelque malentendu.
Je n'ai jamais cherché de plaire au public ; mais je tiens excessivement à l'opinion de quelques uns ; c'est affaire de sentiment et rien ne peut contre cela. Ce que l'on a pris parfois pour une certaine timidité de pensée, n'était le plus souvent que la crainte de contrister ces quelques personnes ; de contrister une âme, en particulier, qui de tout temps me fut chère entre toutes. Qui dira de combien d'arrêts, de réticences et de détours est responsable la sympathie, la tendresse ? — Pour ce qui est des simples retards, je ne puis les tenir pour regrettables, estimant que les artistes de notre temps pèchent le plus souvent par grand défaut de patience. Ce que l'on nous sert aujourd'hui eût souvent gagné à mûrir. Telle pensée qui d'abord nous occupe et nous paraît éblouissante, n'attend que demain pour flétrir. C'est pourquoi j'ai longtemps attendu pour écrire ce livre, et l'ayant écrit, pour l'imprimer. Je voulais être sûr que ce que j'avançais dans Corydon, et qui me paraissait évident, je n'allais pas avoir bientôt à m'en dédire. Mais non : ma pensée n'a fait ici que s'affermir, et ce que je reproche à présent à mon livre, c'est sa réserve et sa timidité. Depuis plus de dix ans qu'il est écrit, exemples, arguments nouveaux, témoignages, sont venus corroborer mes théories. Ce que je pensais avant la guerre, je le pense plus fort aujourd'hui. L'indignation que Corydon pourra provoquer, ne m'empêchera pas de croire que les choses que je dis ici doivent être dites. Non que j'estime que tout ce que l'on pense doive être dit, et dit n'importe quand, — mais bien ceci précisément, et qu'il faut le dire aujourd'hui ! (1)
Certains amis, à qui j'avais d'abord soumis ce livre, estiment que je m'y occupe trop des questions d'histoire naturelle — encore que je n'aie point tort, sans doute, de leur accorder tant d'importance ; mais, disent-ils, ces questions fatigueront et rebuteront les lecteurs. — Eh parbleu ! c'est bien ce que j'espère : je n'écris pas pour amuser et prétends décevoir dès le seuil ceux qui chercheront ici du plaisir, de l'art, de l'esprit ou quoi que ce soit d'autre enfin que l'expression la plus simple d'une pensée très sérieuse. —
Encore ceci :
Je ne crois nullement que le dernier mot de la sagesse soit de s'abandonner à la nature, et de laisser libre cours aux instincts ; mais je crois qu'avant de chercher à les réduire et domestiquer, il importe de bien les comprendre — car nombre des disharmonies dont nous avons à souffrir ne sont qu'apparentes et dues uniquement à des erreurs d'interprétations.
Nov. 1922.
1. Certains livres — ceux de Proust en particulier — ont habitué le public à s'effaroucher moins et à considérer de sang-froid ce qu'il feignait d'ignorer, ou préférait ignorer d'abord. Nombre d'esprits se figurent volontiers qu'ils suppriment ce qu'ils ignorent ... Mais ces livres, du même coup, ont beaucoup contribué, je le crains, à égarer l'opinion. La théorie de l'homme-femme, des " Sexuelle Zwischenstufen " (degrés intermédiaires de la sexualité) que lançait le Dr Hirschfeld en Allemagne, assez longtemps déjà avant la guerre, et à laquelle Proust semble se ranger — peut bien n'être point fausse ; mais elle n'explique et ne concerne que certains cas d'homosexualité, ceux précisément dont je ne m'occupe pas dans ce livre — les cas d'inversion, d'efféminement, de sodomie. Et je vois bien aujourd'hui qu'un des grands défauts de mon livre est précisément de ne point m'occuper d'eux — qui se découvrent être beaucoup plus fréquents que je ne le croyais d'abord.
Et mettons que, ceux-ci, la théorie de Hirschfeld les satisfasse. Cette théorie du " troisième sexe " ne saurait aucunement expliquer ce qu'on a coutume d'appeler " l'amour grec ": la pédérastie — qui ne comporte efféminement aucun, de part ni d'autre.
Le Visiteur entrant dans le bureau du Dr Corydon y observe une reproduction du tableau de Michel-Ange La création d’Adam (Chapelle Sixtine, Vatican, Rome).
Ce dialogue développe, à partir d'un fait-divers qui reste anonyme, l'exigence d'un jugement équitable par l'opinion publique (I, i). Vient ensuite l'histoire d'Alexis B. et de Corydon son aimé (dans l'églogue de Virgile, c'était Corydon qui aimait le jeune Alexis, et non l'inverse.) ; l'adolescent se suicida par désespoir d'amour (I, ii, page 26) ; le récit de ce drame fut inspiré par des faits réels (suicide d'Émile Ambresin, l'Armand Bavretel de Si le grain ne meurt), et par un petit récit, non publié, de l'ami Henri Ghéon, L'Adolescent, texte que Gide avait pu lire en 1907.
Alors que le Hongrois Karl-Maria Kertbeny (1824-1882) était jeune apprenti chez un libraire, un de ses amis proches, homosexuel, se suicida à la suite d'un chantage exercé sur lui. Kertbeny expliqua plus tard que c'était à la suite de cet épisode tragique qu'il avait ressenti une impérieuse nécessité à combattre cette forme d'injustice et qu'il s'était intéressé de près à ce qu'il nomma Homosexualität. Le suicide des adolescents homosexuels reste encore aujourd'hui une motivation importante de l'action pour la compréhension et l'acceptation de l'homosexualité.
Le Dr Corydon se présente comme un cas de révélation relativement tardive du désir homosexuel, à l'instar de Michel dans L'Immoraliste (Journal, 26 novembre 1915) et de Gide lui-même : à l'âge de 24 ans, avec le jeune Tunisien Ali. Des relations pédérastiques de Gide, éphémères ou plus durables, treize sont parvenues à la connaissance du public : celles avec Ali, Athman (18 ans), Alexandre S. (alors âgé de 15 ans), Émile X. (15 ans), Gérard P., Maurice Schlumberger (19 ans), Ferdinand Pouzac, dit « le ramier » (17 ans, mais Gide le croyait âgé de 15 ans), Lazare Coulon (novembre 1912), Jean Billet (octobre 1915), Marc Allegret (à partir de 16 ou 17 ans), Louis Valérien (moissonneur), Émile D. et Gaby ; ses avances à François Derais (15 ans) furent repoussées.
L'affirmation théorique centrale (I, iii) est que l'uranisme n'est pas, en soi, une maladie, thèse soutenue par le psychologue Marc André Raffalovich dès 1896, par plusieurs médecins lors du Ve Congrès d'anthropologie criminelle de 1901 à Amsterdam, et aussi par Sigmund Freud en 1905. Le Dr Corydon affirme qu’il existe des « pédérastes normaux », selon l'expression ironique, qu'il reprend du Visiteur (I, iii, page 29), qui ne sont pas ceux que voient les médecins :
« Je prétends n'y point parler en spécialiste, mais en homme. Les médecins qui d'ordinaire traitent de ces matières n'ont affaire qu’à des uranistes honteux ; qu’à des piteux, qu’à des plaintifs, qu’à des invertis, des malades. Ceux-là seuls viennent les trouver. En tant que médecin, c'est bien aussi de ceux-là que je soigne ; mais, en tant qu'homme, j'en rencontre d'autres, ni chétifs, ni plaintifs, — c'est sur eux qu'il me plait de tabler.
— Oui, sur les pédérastes normaux !» (I, iii, page 28).
L’expression « pédérastes normaux » sera à nouveau contestée par le Visiteur dans le quatrième dialogue : « Ceux que vous avez le front d’appeler les pédérastes normaux » (IV, page 123). Le Dr Corydon :
« — Vous l'avez dit. Comprenez-moi : l’homosexualité, tout comme l’hétérosexualité, comporte tous les degrés, toutes les nuances : du platonisme à la salacité, de l’abnégation au sadisme, de la santé joyeuse à la morosité, de la simple expansion à tous les raffinements du vice. L’inversion n’en est qu’une annexe. De plus tous les intermédiaires existent entre l’exclusive homosexualité et l’hétérosexualité exclusive. Mais, d'ordinaire, il s'agit bonnement d'opposer à l'amour normal un amour réputé contre nature — et, pour plus de commodité, on met toute la joie, toute la passion noble ou tragique, toute la beauté du geste et de l'esprit d'un côté ; de l'autre, je ne sais quel rebut fangeux de l'amour ... » (I, iii, page 29).
L'existence de ces intermédiaires, c’est ce que la princesse Palatine, belle sœur de Louis XIV, dans sa Correspondance, puis Marc Raffalovich, ainsi que Guy Debrouze dans la revue Akademos (juillet 1909) avaient déjà observé. Gide conteste la théorie du troisième sexe, alors répandue en Allemagne à partir des publications de Karl Heinrich Ulrichs (années 1860) suivies de celles du sexologue Magnus Hirschfeld, théorie à laquelle s'était rallié Marcel Proust et déjà critiquée dans la préface de 1922 (page 8). Corydon offre (I, i, pages 19-21 et I, iii, pages 29-30), des échos de procès de mœurs, sur lesquels Gide et son ami Henri Ghéon conservaient des coupures de presse : les procès d'Oscar Wilde en 1895 ; l’affaire des télégraphistes [J'ai hélas perdu ma note « Le champagne des télégraphistes » ; qui était sur le site mort www.multimania.com/jgir/Kadémos], le suicide du général MacDonald et le procès de Jacques d'Adelswärd-Fersen, tout ça en en 1903.
Les procès en diffamation contre le journaliste allemand Harden en 1907-1908 ; le procès Renard de 1909 fait l’objet d’une note dans le quatrième dialogue (IV, page 123).
La dissymétrie pédérastique est exposée : « On est en droit d’attendre quelque beauté de l’objet du désir, mais non point du sujet qui désire. Peu me chaut la beauté de ceux-ci. » (I, iii, page 30). Le Dr Corydon ne relève pas cette pique :
« —Mais enfin vous m'impatientez ! Le mariage, l’honnête mariage est là, et pas de votre côté je suppose. Je me sens, en face de vous, de l'humeur de ces moralistes, qui, hors du conjugo, ne voient dans le plaisir de la chair que péché et réprouvent toutes relations à l'exception des légitimes. » (I, iii, page 31).
Certains de ces thèmes feront retour dans le quatrième dialogue ; la forte remarque des étudiants du Comité d'Action Pédérastique Révolutionnaire en mai 1968, " l’attitude de soumission, les yeux de chiens battus, le genre rase-les-murs de l'homosexuel type ", y est anticipée avec ce refus « De l'hypocrisie. Du mensonge. De cette allure de contrebandier à quoi vous contraignez l'uraniste. » (IV, page 124). Pour autant, André Gide n'était pas l'annonciateur des débordements LGBT (voire LGBTQI+) de la Gay Pride ... ; son traitement de la question est culturel et non politique, et il y avait un gros contre-sens dans le titre d’un essai de Monique Nemer, Corydon citoyen. Essai sur André Gide et l'homosexualité (Paris : Gallimard, 2006, collection "blanche").
DEUXIÈME DIALOGUE
Il nécessita un gros travail de documentation ; le Dr Corydon, comme annoncé, aborde l'histoire naturelle : « C'est en naturaliste que je m'apprête à vous parler, rassurez-vous. J'ai rangé mes observations ; si je voulais les utiliser toutes, trois volumes n'y suffiraient pas. » (II, page 35) ; selon l'éthologue américain Frank A. Beach (1911-1988), il ne s'en serait pas si mal sorti :
« We find ourselves, then, agreeing with Gide in his contention that homosexual behavior should be classified as natural from the evolutionary and physiological point of view » (Comments on the second Dialogue, 1949).Le point faible, relevé par Frank Beach, est évidemment d'avoir laissé de côté le lesbianisme ; André Gide le savait, en témoigne cette note non conservée sur les épreuves de l'édition de 1924 :
« Je lui reproche (à Corydon) bien des choses. En particulier de laisser dans l'ombre certains côtés de la question : l'homosexualité chez la femme, par exemple. »
Gide conteste, avec le nationalisme du Visiteur et sa théorie du vice étranger (II, i, pages 37-38), l'affirmation du critique Jean Ernest-Charles [Paul Renaison] selon laquelle la pédérastie répugnerait à la mentalité française (Grande Revue, 25 juillet 1910, page 399). Après avoir cité Pascal et La Rochefoucauld, il expose sa priorité :
« Disons pour simplifier, si vous le voulez bien, qu'il est des instincts sociaux et des instincts antisociaux. Si la pédérastie est un instinct antisocial, c’est ce que j’examine dans la seconde et la troisième partie de mon livre ; permettez-moi de différer la question. Il me faut tout d’abord, non point seulement constater et reconnaître l’homosexualité pour naturelle, mais bien encore tenter de l’expliquer et de comprendre sa raison d’être. Ces quelques remarques préliminaires n'étaient peut-être pas de trop, car, autant que je vous avertisse : ce que je m’apprête à formuler n’est rien de moins qu’une théorie nouvelle de l’amour.— Peste ! Est-ce que vraiment l'ancienne ne vous suffisait pas ?— Apparemment non, puisqu'elle tend à faire de la pédérastie une entreprise " contre nature "... Nous vivons, enfoncés jusqu'aux yeux et jusqu'à la cervelle dans une théorie de l'amour très vieille, très commune et que nous ne songeons plus à discuter ; cette théorie a pénétré fort avant dans l'histoire naturelle, faussé maint raisonnement, perverti mainte observation ; je crains d'avoir du mal à vous en dégager durant quelques instants de causerie... » (II, i, pages 40-41).
Il rappelle l’orientation essentiellement philosophique des dialogues :
Il discute la pertinence de la notion d’instinct sexuel et conclut :
Les points forts sont :
Le Visiteur résume :
« — On a beaucoup écrit sur l’amour ; mais les théoriciens de l’amour sont rares. En vérité, depuis Platon et les convives de son Banquet, je n’en reconnais point d’autre que [Arthur] Schopenhauer. » (II, ii, pages 41-42).
« — Peut-être en effet y fallait-il quelqu'un que gênât la théorie régnante. Remarquez je vous prie que Schopenhauer et Platon ont compris qu’ils devaient, dans leurs théories, tenir compte de l’uranisme ; ils ne pouvaient faire autrement ; Platon lui fait, même, la part si belle que je comprends que vous en soyez alarmé ; quant à Schopenhauer, de qui la théorie prévaut, il ne le considère que comme une manière d’exception à la règle, exception qu'il explique spécieusement, mais inexactement, comme je vous le montrerai par la suite. En biologie, comme en physique, je vous avoue que les exceptions me font peur ; mon esprit s'y achoppe, comprend mal une loi naturelle qui n'englobe que sous réserves, une loi qui permette, qui contraigne d'échapper. » (II, ii, pages 45-46).
« [...] le plaisir n'est pas à ce point lié à sa fin qu'il ne s'en puisse disjoindre, qu'il ne s'émancipe aisément. La volupté dès lors est recherchée pour elle-même, sans souci de la fécondation. Ce n’est pas la fécondation que cherche l’animal, c’est simplement la volupté. Il cherche la volupté — et trouve la fécondation par raccroc. » (II, ii, page 45).
1) l'homosexualité n'est pas contre nature en raison de la surproduction de l'élément mâle (II,iii) qui fait que " ces pertes chimériques sont entièrement indifférentes à la nature (1) ", et de l'existence d'une homosexualité animale, de " jeux homosexuels " (II, vi, pages 68 et 71) se produisant « "même en présence de beaucoup de femelles", comme disait Muccioli. » (II, vi, page 71). Cette homosexualité animale était reconnue, parfois contestée, déjà dans l'Antiquité, ce dont Gide n'avait sans doute pas connaissance.
Mentionnons ici Havelock Ellis (Sexual Inversion, 1897, 2e édition 1901, dont la traduction française paraît en mai 1909 au Mercure de France ; la traduction de cette 2e édition fournit un élément (parmi d'autres) de terminus ad quem pour Corydon, car c'est grâce à Havelock Ellis que Gide prit connaissance des observations de Muccioli sur les pigeons (II, vi, page 67) et de celles d’Alexandre Lacassagne sur les poulains (II, vi, page 68).
Dans son article « De la criminalité chez les animaux », Revue scientifique de la France et de l’étranger, numéro 2, 14 janvier 1882, page 37, Alexandre Lacassagne outait aussi les taurillons et les petits chiens ...
Revenant enfin à l'espèce humaine, le Dr Corydon mentionne les propos de Sainte-Claire-Deville sur « l'internat et son influence sur l’éducation de la jeunesse » (II, vi, page 71).
Dans son article « De la criminalité chez les animaux », Revue scientifique de la France et de l’étranger, numéro 2, 14 janvier 1882, page 37, Alexandre Lacassagne outait aussi les taurillons et les petits chiens ...
Revenant enfin à l'espèce humaine, le Dr Corydon mentionne les propos de Sainte-Claire-Deville sur « l'internat et son influence sur l’éducation de la jeunesse » (II, vi, page 71).
2) Gide en vient à la conclusion logique que l'hétérosexualité masculine exclusive n'est pas une loi naturelle immuable (II, vii, page 78).
L’idée de la supériorité du sexe féminin, avancée par le botaniste féministe Lester F. Ward (1841-1913), lui paraît « peu philosophique » (II, iii, page 48). L'argument de la plus grande beauté et intelligence du mâle (II, iv, p. 52) est diversement apprécié, parfois considéré comme misogyne. Le Journal nous fait savoir que Gide n’était pas convaincu de l’intelligence des femmes :
« Il y a toujours certains points par où la plus intelligente des femmes reste, dans le raisonnement, au-dessous du moins intelligent des hommes. Une sorte de convention s’établit, où entre beaucoup d’égards pour le sexe " à qui nous devons notre mère " et pour quantité de raisonnements claudicants, lesquels nous ne supporterions pas s’ils venaient d’un homme. Je sais bien que pourtant leur conseil peut être excellent, mais à condition de le rectifier sans cesse et de l’expurger de cette part de passion et d’émotivité qui, presque toujours, chez la femme, vient sentimentaliser la pensée. » (octobre 1940).
Sur ce point de la beauté masculine, Gide était en accord avec Frédéric Nietzsche ;
Le Gai Savoir, II, § 72 : " Chez les animaux, le sexe masculin est considéré comme le beau. "
et
Le Crépuscule des Idoles, " Divagations d'un inactuel ", § 47 : " À Athènes, du temps de Cicéron, qui en exprime son étonnement [Tusculanes, IV], les hommes et les adolescents surpassaient de loin les femmes en beauté: mais quel travail, quels efforts le sexe masculin ne s'était-il pas imposés à Athènes, depuis des siècles, au seul service de la beauté ! ".
Le mâle des espèces supérieures est caractérisé comme un être de luxe et de dépense, d'intelligence et de jeu, cet état de fait relevant des « conséquences de la surproduction de l’élément mâle » (II, iv, page 56). La mention du philosophe anglais Francis Bacon (II, vi, page 64), à propos de l'expérience cruciale, a pour fonction d'ancrer encore davantage (après les références à Platon et Arthur Schopenhauer) l'étude de la question homosexuelle dans une démarche rationnelle, logique et philosophique ; elle vise d’abord à l'extraire du domaine d'influence des préjugés populaires, mais aussi bien à l'écarter d'une approche purement littéraire (celle de Proust et de Cocteau par exemple), souvent dépourvue de rigueur argumentaire et documentaire, et qui se gausse des questions d’histoire naturelle et des éléments de zoologie figurant dans Corydon.
Le Gai Savoir, II, § 72 : " Chez les animaux, le sexe masculin est considéré comme le beau. "
et
Le Crépuscule des Idoles, " Divagations d'un inactuel ", § 47 : " À Athènes, du temps de Cicéron, qui en exprime son étonnement [Tusculanes, IV], les hommes et les adolescents surpassaient de loin les femmes en beauté: mais quel travail, quels efforts le sexe masculin ne s'était-il pas imposés à Athènes, depuis des siècles, au seul service de la beauté ! ".
Le mâle des espèces supérieures est caractérisé comme un être de luxe et de dépense, d'intelligence et de jeu, cet état de fait relevant des « conséquences de la surproduction de l’élément mâle » (II, iv, page 56). La mention du philosophe anglais Francis Bacon (II, vi, page 64), à propos de l'expérience cruciale, a pour fonction d'ancrer encore davantage (après les références à Platon et Arthur Schopenhauer) l'étude de la question homosexuelle dans une démarche rationnelle, logique et philosophique ; elle vise d’abord à l'extraire du domaine d'influence des préjugés populaires, mais aussi bien à l'écarter d'une approche purement littéraire (celle de Proust et de Cocteau par exemple), souvent dépourvue de rigueur argumentaire et documentaire, et qui se gausse des questions d’histoire naturelle et des éléments de zoologie figurant dans Corydon.
Enfin, on peut se demander si le blanc relatif à un passage de Pantagruel (II, vi, page 65) est délibéré ou s'il s'agit d'une négligence, ou encore d'une trace volontairement laissée de l'état d'inachèvement dans lequel étaient C. R. D. N. et le texte de 1920 - comme pour demander la participation active du lecteur dans l'acte de se reporter au texte de Rabelais.
TROISIÈME DIALOGUE
Après une remarque méthodologique bien dans la lignée de Montaigne sur l’indispensable distinction « entre la remise au point des faits et l'explication qu'on en donne » (III, page 82), le Dr Corydon fait remarquer à son Interviewer que, l'odorat ne jouant pratiquement aucun rôle chez l'homme (III, i, page 82), l'amour tourne au jeu et le désir se diversifie (III,i, page 85). Gide reprend :
« du bas en haut de l’échelle animale, nous avons dû constater, dans tous les couples animaux, l’éclatante suprématie de la beauté masculine (dont j’ai tenté de vous offrir le motif) ; qu’il est assez déconcertant de voir le couple humain, tout à coup, renverser cette hiérarchie ; que les raisons que l’on a pu fournir de ce subit retournement demeurent ou mystiques ou impertinentes – au point que certains sceptiques se sont demandé si la beauté de la femme ne résidait pas principalement dans le désir de l’homme » (III, ii, page 86),et accumule diverses citations ; les travaux préparatoires montrent qu'il avait envisagé de citer un extrait du Voyage à Ceylan de l'anthropologue Ernst Häckel, un passage sur la beauté des Ceylaniens (emprunt fait à Edward Carpenter).
L'attrait hétérosexuel pour la femme doit être soutenu par l'entretien d'une beauté artificielle qu'il considère comme un attrait « postiche » (III, i, page 84, III, ii, page 88 et III, iv, page 101) ; ce qui, par différence, fait paraître l'homosexualité masculine « plus spontanée, plus naïve que l’hétérosexualité » (III, iv, page 95), et la pédérastie « comme un instinct très naïf et primesautier » (III, iv, page 98). Lors de considérations esthétiques, il est amené à mentionner le Concert champêtre, indiqué comme étant de Giorgione mais actuellement attribué à Titien :
« Plastiquement, linéairement du moins, on n’oserait affirmer que les corps de ces femmes sont beaux ; too fat, comme dit Stevenson ; mais quelle blondeur de matière ! quelle molle, profonde et chantante luminosité ! Ne peut-on dire que, si la beauté masculine triomphe dans la sculpture, par contre la chair féminine prête plus au jeu des couleurs ? » (III, iii, pages 93-94)
Gide attire l’attention du Visiteur sur « des groupes de seigneurs : deux de-ci, deux de-là, en postures peu équivoques » (Corydon, III, iii, page 94) dans le Concile de Trente, également de Titien.
Le Visiteur résume :
« je vous entends bien à présent : le " naturel " pour vous c’est l’homosexualité ; et ce que l’humanité avait encore l’impertinence de considérer comme les rapports normaux et naturels, ceux entre l’homme et la femme, voilà pour vous l’artificiel. Allons ! osez le dire. » (III, iv, page 102).Ce à quoi le Dr Corydon oppose cette conclusion :
« J’observais que l’artifice souvent, et la dissimulation (dont la forme noble est pudeur), que l’ornement et le voile subviennent à l’insuffisance d’attrait … Est-ce à dire que certains hommes ne seraient pas attirés irrésistiblement vers la femme (ou vers telle femme en particulier) quand bien dénuée de parure ? Non certes ! comme nous en voyons d’autres qui, malgré toutes les sollicitations du beau sexe, les injonctions, les prescriptions, le péril, demeurent irrésistiblement attirés par les garçons. Mais je prétends que, dans la plupart des cas, l'appétit qui se réveille en l'adolescent n’est pas d’une bien précise exigence ; que la volupté lui sourit, de quelque sexe que soit la créature qui la dispense, et qu’il est redevable de ses mœurs plutôt à la leçon du dehors, qu’à la décision du désir ; ou, si vous préférez, je dis qu’il est rare que le désir se précise de lui-même et sans l’appui de l’expérience. Il est rare que les données des premières expériences soient dictées uniquement par le désir, soient celles-là même que le désir eût choisies. Il n’est pas de vocation plus facile à fausser que la sensuelle, et … » (III, v, pages 103-104).
Gide pensait probablement à ses propres premières relations hétérosexuelles en Algérie.
NOTE
1. Marquis de Sade, Augustine de Villebranche, début (note de Cl. C.) :
« A-t-on peur que les caprices de ces individus de l'un ou l'autre sexe ne fassent finir le monde, qu'ils ne mettent l'enchère à la précieuse espèce humaine, et que leur prétendu crime ne l'anéantisse, faute de procéder à sa multiplication ? Qu'on y réfléchisse bien et l'on verra que toutes ces pertes chimériques sont entièrement indifférentes à la nature, que non seulement elle ne les condamne point, mais qu'elle nous prouve par mille exemples qu'elle les veut et qu'elle les désire; eh, si ces pertes l'irritaient, les tolérerait-elle dans mille cas, permettrait-elle, si la progéniture lui était si essentielle, qu'une femme ne pût y servir qu'un tiers de sa vie et qu'au sortir de ses mains la moitié des êtres qu'elle produit eussent le goût contraire à cette progéniture néanmoins exigée par elle ? Disons mieux, elle permet que les espèces se multiplient, mais elle ne l'exige point, et bien certaine qu'il y aura toujours plus d'individus qu'il ne lui en faut, elle est loin de contrarier les penchants de ceux qui n'ont pas la propagation en usage et qui répugnent à s'y conformer. »
QUATRIÈME DIALOGUE
L'utilité sociale de la pédérastie est examinée en opposition avec le mal de la prostitution. Il s'agit ici de pédérastie au sens grec du mot (relation amoureuse avec un adolescent déjà formé, pubère donc), et de son rapport direct avec les progrès des arts plastiques et ceux de la philosophie en Grèce antique. Quelques lignes de Frédéric Nietzsche, relatives à l'esclavage et à la guerre, sont détournées vers l'amour grec (page 111) :
« La guerre est aussi nécessaire à l'État que l'esclave à la société. Et qui pourrait vraiment se dérober à de telles réflexions s'il s'interroge honnêtement sur les fondements de la perfection inégalée de l'art grec. » (L'État chez les Grecs, Écrits posthumes 1870-1873, Paris : Gallimard, 1975 (Œuvres philosophiques complètes). Gide cite d'après Daniel Halévy, La Vie de Frédéric Nietzsche, Paris : Calmann-Lévy, 1909.
Gide aurait pu invoquer au moins deux autres passages, qu'il connaissait sans doute, étant grand lecteur de Nietzsche chez qui il disait avoir trouvé, comme chez Dostoïevski et Sigmund Freud, « plutôt une autorisation qu'un éveil » (Journal, janvier 1924) :
« Les rapports érotiques entre hommes et adolescents furent, à un degré qui échappent à notre compréhension, l'unique et nécessaire condition de toute cette éducation virile. » (Humain, trop humain, V, § 259)
« Qu'est-ce que notre bavardage sur les Grecs ! Que comprenons-nous donc à leur art dont l'âme est - la passion pour la beauté virile nue ! - Ce n'est qu'à partir de là qu'ils ressentaient la beauté féminine. »
(Aurore, III, § 170)
J'ai rassemblé l'ensemble des passages de Nietzsche relatifs à l'homosexualité sous le titre Knabenliebe, Pétrone ...
Deux notes-citations, celle de John Addington Symonds et celle de Bion (IV, pages 111-112 et page 113), ont pour source la lecture de l'anthologie d'Edward Carpenter (1844/1929) Iolaüs. An Anthology of Friendship ; elles évoquent les couples mythiques célèbres, Achille et Patrocle, Thésée et Pirithous, Oreste et Pylade (1).
De longues citations des Vies de Plutarque répondent sans doute au père Paul Gide qui invoquait cet auteur, et veulent montrer que la tolérance de l'amour masculin n'a pas pour conséquence obligatoire la faiblesse militaire, souci alors fort présent dans les esprits ; ces dernières pages de Corydon furent en effet rédigées entre 1915 et 1918 ; précisément, Corydon fut repris "à la fin de la seconde année de la guerre" (Journal, 21 décembre 1923), très probablement après que Gide ait pris connaissance du Iolaüs d'Edward Carpenter sur la 3e édition, imprimée en novembre 1915.
* * * * *
L'originalité de Corydon est de ne pas s'engager dans la "défense syndicale" de tous les homosexuels, mais d’introduire un distinguo-concedo-nego ; il annonce :
« Si vous le voulez bien, nous laisserons de côté les invertis » (IV, page 122) ; « les invertis, dont la tare est trop évidente », lisait-on même dans le texte de 1920. « Je leur tiens à grief ceci, que les gens mal renseignés confondent les homosexuels normaux avec eux. » (IV, pages 122-123) ;cela correspond à ce qu'il exprimait déjà en 1918 dans des Feuillets :
« Quant aux invertis, que j'ai fort peu fréquentés, il m'a toujours paru qu'eux seuls méritaient ce reproche de déformation morale ou intellectuelle et tombaient sous le coup de certaines accusations que l'on adresse communément à tous les homosexuels ».Point de vue voisin, et énergique, chez Marc-André Raffalovich, considéré par certains comme un pionnier du mouvement homosexuel :
« Les rapports qui existent entre la véracité, le mensonge et la vie sexuelle sont étroits. Les efféminés sont menteurs à tous les degrés, depuis la perfidie minutieuse jusqu'à l'inconscience, jusqu'à une incontinence de faussetés. Ils observent mal et reproduisent mal ce qu'ils ont observé. » (Uranisme et unisexualité, 1896).La scission en 1907 du Comité Scientifique Humanitaire (W.H.K.) s’était justement faite sur cette question des invertis. La réticence qui produisit cette scission de 1907 n’était pas propre à Gide ; en juillet 1954, le mensuel FUTUR (1952-1955) se réjouissait de la diminution du nombre des efféminés :
« On peut circuler à Saint-Germain-des-Prés, le samedi soir, sans être choqué, alors qu’il y a quinze ou vingt ans, à Pigalle, que d’homosexuels de tous genres s’affichaient, que de petits jeunes gens ostensiblement maquillés déambulaient ! Les différents cercles ou endroits fréquentés par les disciples de Corydon sont en général bien préférables, au point de vue tenue, à ceux qui existaient avant guerre. »Au début des années 1970, cette question divisa le F.H.A.R., l’anarchiste Daniel Guérin étant (il me l'avait dit) un des plus opposés aux interventions perturbantes des folles et travestis.
Autre réponse faite au père, le lien fait entre hétérosexualité et misogynie dans la décadence d'Athènes « lorsque les Grecs cessèrent de fréquenter les gymnases » (IV, page 119). Gide exprime à nouveau son hostilité foncière au mensonge et à l'hypocrisie, point qui sera réitéré dans une lettre de 1934 adressée à Georges Hérelle (2). Le Dr Corydon s’indigne :
« Il en va toujours de même chaque fois qu’un appétit naturel est systématiquement contrarié. Oui, l'état de nos mœurs tend à faire du penchant homosexuel une école d'hypocrisie, de malice et de révolte contre les lois.
– Osez dire : de crime.
– Évidemment, si vous faîtes de la chose même un crime. Mais c'est bien là précisément ce que je reproche à nos mœurs ; tout comme je fais responsable des trois quarts des avortements la réprobation qui flétrit les filles enceintes. » (IV, pages 123-124)
L’homosexualité pouvait alors en effet être considérée comme un crime, et ceci même chez les animaux, puisque c’est dans un article intitulé « De la criminalité chez les animaux » que le médecin-légiste Alexandre Lacassagne (1843-1924) examinait les rapports entre mâles des poulains, taurillons et jeunes chiens. (Revue scientifique de la France et de l'étranger, n° 2, 14 janvier 1882, page 37).
Au début de l'époque moderne, dans les cas de bestialité (zoophilie), l'animal était brûlé avec le coupable humain.
Au début de l'époque moderne, dans les cas de bestialité (zoophilie), l'animal était brûlé avec le coupable humain.
Le Dr Corydon s'achemine vers sa conclusion :
« Je n'oppose point l'uranisme à la chasteté, mais bien une convoitise, satisfaite ou non, à une autre. Et précisément je soutiens que la paix du ménage, l’honneur de la femme, la respectabilité du foyer, la santé des époux étaient plus sûrement préservés avec les mœurs grecques qu’avec les nôtres ; et de même, la chasteté, la vertu, plus noblement enseignée, plus naturellement atteinte. Pensez-vous que saint Augustin eut plus de mal à s’élever à Dieu, pour avoir donné son cœur d’abord à un ami, qu’il aimait autant que jamais une femme ? Estimez-vous vraiment que la formation uranienne des enfants de l’Antiquité les disposât à la débauche plus que la formation hétérosexuelle de nos écoliers d’aujourd’hui ? Je crois qu’un ami, même au sens le plus grec du mot, est de meilleur conseil pour un adolescent, qu'une amante. Je crois que l’éducation amoureuse d’une Madame de Warens, par exemple, sut donner au jeune Jean-Jacques fut autrement néfaste pour celui-ci que ne l’eût été n’importe quelle éducation spartiate ou thébaine. Oui, je crois que Jean-Jacques serait sorti moins vicié et même, vis-à-vis des femmes, plus... viril, s'il avait suivi d'un peu plus près l'exemple de ces héros de Plutarque, que pourtant il admirait si fort. » (IV, page 125).Ici encore, on ne peut s'empêcher de penser à Nietzsche :
« Ce qui a favorisé le GRAND NOMBRE de libres individus chez les Grecs (...) L'amour des garçons propre à divertir de la vénération des femmes et de leur influence amollissante.» (Frédéric Nietzsche, Fragments posthumes, M III 1, printemps-automne 1881, 11[97], Paris : Gallimard, 1982, Œuvres philosophiques complètes).
« L'imagination dépravée de la femme : c'est cela qui gâte la race, plus que le rapport physique avec l'homme. » (W I 2, été-automne 1884, 26[362]).
* * * * *
L'optimisme de Gide, manifesté par l'espoir d'une audience durable pour ses dialogues socratiques (Corydon), peut aujourd'hui être mis en perspective avec les conclusions pessimistes de son contemporain Georges Hérelle quant à une éventuelle renaissance de la pédérastie. Une étude sur l'amour grec, intitulée Päderastie, fut publiée par l'allemand M. H. E. Meier en 1837, traduite et annotée en 1930 sous le pseudonyme de L.R. de Pogey-Castries et sous le titre Histoire de l'amour grec (rééditions en 1952 et 1980). Son auteur était Georges Hérelle (1848/1934), originaire de Pougy le Château (Aube), traducteur de Gabriele D'Annunzio et de Blasco Ibañez, et professeur de philosophie ; il laissa de nombreux manuscrits, dont un volumineux projet de Nouvelles études sur l'amour grec, à la Bibliothèque Municipale de Troyes (Aube). L'analyse d'Hérelle, envisage, comme celle de Gide, la situation historiquement faite à la femme par la pédérastie, mais en tire un enseignement opposé, plus favorable à l'avenir de l'hétérosexualité, car " l'âme féminine a pris une énorme importance dans la vie sociale " (Manuscrit n° 3188, f° 490, Bibliothèque municipale de Troyes).
* * * * *
En synthétisant une argumentation jusqu'alors éparse, André Gide mit toute son audience au service de la justification de l'amour masculin, ou au moins de sa forme pédérastique ; de nombreux lecteurs apprécièrent, le lui écrivirent, joignant parfois à leurs remerciements des confessions érotiques de valeur, qui ont été conservées et devront un jour être publiées. Une de ces lettres, celle d'André Hagège (nom révélé par la consultation de l'original), fut publiée dans les Œuvres complètes, à la suite de Corydon (tome IX, 1935, pages 342-347) ; le Dr André Hagège est décédé à Paris le 21 mai 1992.
L'audace de l'écrivain était liée, de près ou de loin, à des démarches collectives plus ou moins éphémères. L'existence en 1909 de la revue Akademos, dont l'article " Le préjugé contre les mœurs ", paru dans le numéro 7 du 15 juillet, anticipait fortement sur Corydon, fut sans doute stimulante pour un auteur éprouvant " l'appréhension qu'un autre [le] devance " (Journal, 12 juillet 1910). Mérite aussi d'être signalé, l'article de Georges Eekhoud " De la sensibilité dans la littérature moderne ", Akademos, n° 8, 15 août 1909, pages 254-267.
Depuis 1902, les chroniques d'Henri Albert (1868-1921) dans la revue littéraire Mercure de France (1889-1965) apportaient régulièrement des nouvelles du comité allemand de Magnus Hirschfeld et de ses publications ; Henri Albert était par ailleurs traducteur de Nietzsche ; voir le travail du Dr Patrick Pollard, André Gide, Homosexual Moralist, New Haven/London : Yale University Press, 1991. (Recensement des sources sociologiques et littéraires utilisées par Gide pour Corydon, influences subies, méthodes de travail et mobiles probables de ses choix.).
Depuis 1902, les chroniques d'Henri Albert (1868-1921) dans la revue littéraire Mercure de France (1889-1965) apportaient régulièrement des nouvelles du comité allemand de Magnus Hirschfeld et de ses publications ; Henri Albert était par ailleurs traducteur de Nietzsche ; voir le travail du Dr Patrick Pollard, André Gide, Homosexual Moralist, New Haven/London : Yale University Press, 1991. (Recensement des sources sociologiques et littéraires utilisées par Gide pour Corydon, influences subies, méthodes de travail et mobiles probables de ses choix.).
Du côté des effets, ils furent quasi-immédiats avec l'apparition en novembre 1924 du mensuel Inversions ; le numéro 5 et dernier date de mars 1925 ; le Cartel des gauches ne tarda pas à faire interdire cette publication. L'action collective reprit peu après la mort de Gide : en 1952, Jean-Jacques Thierry fonda les cahiers trimestriels Prétexte et Jean Thibault le mensuel Futur ; parmi les collaborateurs de ces revues, et de leurs rejetons directs (Gioventù, 1956 ; Prétexte, nouvelle série, 1958 ; Juventus, 1959), on relève les noms encore connus aujourd'hui d'André Du Dognon, Jacques Siclier (alors journaliste au Monde), Roger Stéphane et Roger Peyrefitte.
* * * * *
Les écrivains Jean Paulhan et Paul Léautaud firent à Corydon un accueil favorable. Henri de Montherlant, intéressé mais déçu, déplora de n'y point voir un "monument", à la manière de Si le grain ne meurt, publié en octobre 1926 : " Corydon, livre où il y a encore de la feinte, et si inutile ! De la petite précaution, et pour ne tromper personne ! On s’étonne aussi, connaissant la culture de Gide, que sa thèse, – pardon, la thèse du nommé Corydon – ne soit pas davantage étayée. Gide, sur un sujet de cette importance, se devait de donner un monument. Corydon est-il un monument ? (1) Si le grain ne meurt a réparé cela. " ("Acheminement vers Gide", Revue du Capitole, 1928).
1. On peut s'interroger de même sur La Défaite de la pensée de Finkielkraut et le Traité d'athéologie d'Onfray.François Porché publia fin 1927 chez Grasset un livre, L'amour qui n'ose pas dire son nom, auquel Gide fit une réponse publié dans la NRF (janvier 1929) puis dans les éditions ultérieures de Corydon (pages 131-137), réponse elle-même suivie d'une réponse de François Porché datée du 2 janvier 1929 (pages 138-143). Voir, sur le site e-gide, Lettre de François Porché.
Dans son article " André Gide et ses nouveaux adversaires ", Walter Benjamin notait : " Que le Corydon de Gide, qui présente la pédérastie selon ses conditionnements et ses analogies biologiques, ait pu déchaîner une tempête, on le conçoit sans peine. " Sur cette tempête, on pourra se reporter au dossier de presse du Bulletin des Amis d’André Gide.
L'enquête sur André Gide de 1931 (janvier-avril) dans la revue Latinité offrait ces commentaires :
Lorenzo Gigli :
Pierre Drieu La Rochelle vit en Gide « un philosophe au sens socratique du mot, ou un honnête homme ».
Jean Tenant : " Je n'ai pas insisté sur... l'anomalie gidienne. Sur ce point-là, aucun sophisme, aucune théorie ne saurait retenir un seul instant ma pensée. L'animal qui, paraît-il, sommeille au cœur de tout homme, ne saurait changer de nom pour complaire à M. Gide et à ses « disciples ». Et Corydon, en dépit des notes et références, est un livre dégoûtant. "
Dans son article " André Gide et ses nouveaux adversaires ", Walter Benjamin notait : " Que le Corydon de Gide, qui présente la pédérastie selon ses conditionnements et ses analogies biologiques, ait pu déchaîner une tempête, on le conçoit sans peine. " Sur cette tempête, on pourra se reporter au dossier de presse du Bulletin des Amis d’André Gide.
L'enquête sur André Gide de 1931 (janvier-avril) dans la revue Latinité offrait ces commentaires :
Lorenzo Gigli :
" J'admire Gide, intellect puissamment organisé, dialecticien lucide, styliste à grandes ressources ; mais son corydonisme me répugne. Si la position paradoxale dans laquelle il met son rigorisme calviniste de defensor intransigeant et orthodoxe de thèses hétérodoxissimes est susceptible de m'intéresser, personne ne pourra m'ôter le soupçon que Gide se met de parti pris dans les situations les plus équivoques pour faire parler de lui, de même qu'Alcibiade coupant la queue à son chien. J'admire Gide, mais je n'admire pas le gidisme ; j'estime dangereuse l'influence de Gide sur certains champions de la nouvelle génération littéraire, dilettantes de l'équivoque et de la perversité, qui peuplent leurs livres de cyniques « immoralistes », de déracinés, d'épaves, représentés non pas avec l'humaine pitié de l'artiste véritable, mais seulement par une curiosité morbide du mal. "Lucie Delarue-Mardrus ;
" Près de deux mille ans de ligne droite (au sens géométrique du mot) ne sauraient s'inquiéter de soixante ans de méandres gidiens. En ne restant que dans ce domaine mathématique, sans parler du reste, nous apprenons un peu de modestie. Je ne crois pas, malgré toute mon admiration, que, dans 1930 ans, tel passage de Corydon remplacera partout le 'Je crois en Dieu' de l'humanité catholique. "Camille Mauclair : " Il n'y a pas très longtemps qu'un livre tel que Corydon eût suffi à disqualifier pour jamais son auteur. L'homosexualité avouée de M. Gide n'eût concerné que lui. Ce qu'on eût pu juger répugnant, monstrueux, fût demeuré clandestin, et la critique n'eût point eu à s'en occuper. Mais il en a fait une religion. Il a accompli avec une triste habileté l'union du piétisme et de la sensualité dépravée. Il a ainsi réussi ce qu'avait esquissé le lamentable Wilde, qui influa tant sur lui. Il a contribué, avec une froide et tenace préméditation, à pourrir beaucoup d'âmes de jeunes gens. On peut vraiment le définir par le titre d'un des ouvrages de feu Guillaume Apollinaire, autre porteur de bacilles intellectuels : « L'Enchanteur pourrissant ». Et l'apostolat de Corydon est encore moins grave que la sorte de malaise stérilisant que M. Gide a répandu partout. "
Pierre Drieu La Rochelle vit en Gide « un philosophe au sens socratique du mot, ou un honnête homme ».
Jean Tenant : " Je n'ai pas insisté sur... l'anomalie gidienne. Sur ce point-là, aucun sophisme, aucune théorie ne saurait retenir un seul instant ma pensée. L'animal qui, paraît-il, sommeille au cœur de tout homme, ne saurait changer de nom pour complaire à M. Gide et à ses « disciples ». Et Corydon, en dépit des notes et références, est un livre dégoûtant. "
Julien Green : « [Robert de Saint Jean] me dit que tout ce qu'on écrira sur ce sujet ne changera rien à l'attitude de la majorité à l'égard des homosexuels, que Corydon est un livre inutile, que l'opposition est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était au moment où Corydon a paru. Sans doute, mais je crois qu'il y a quarante ans le monde, ce qu'on appelle le monde, cinq cents personnes à Paris, n'eût pas admis qu'un homme avouât ses goûts, les affichât, alors qu'aujourd'hui cela ne souffre aucune difficulté, bien au contraire. Deux hommes liés ensemble ne craignent pas de se montrer ensemble dans les salons. Est-ce un progrès dans la tolérance ? Je ne sais pas. Je crois que dans ce domaine aucun résultat n'est acquis de façon définitive. Il se peut que demain il y ait une persécution très dure de l'homosexualité et que le monde revienne sur ses anciennes positions. Du reste, le monde est composé en grande partie d'imbéciles et de lâches, et son opinion est sujette à trop de fluctuations pour qu'on puisse en tenir compte. Je crois que le gros de l'humanité haïra toujours l'homosexuel (je ne dis pas l'homosexuelle), mais dans la rage de l'hétérosexuel contre l'homosexuel, comme le remarquait D. [Robert de Saint Jean], il y a la haine du piéton pour le monsieur qui passe en voiture (mettons) ou si l'on veut la haine de celui qui est furieux, dans son subconscient, de ne pas avoir éprouvé ce qu'éprouve son voisin. " Tu jouis d'un plaisir que j'ignore. Donc je le réprouve et je te déteste ". »
Toute ma vie Journal intégral *** 1946-1950, 1er mai 1950, Paris : Bouquins éditions, 2021.
Gide s'engage seulement sur le principe de la validité entière de l'amour masculin (lorsqu’il est dépourvu d’inversion, soit en gros le transgenrisme d'aujourd'hui) compte-tenu non seulement de son caractère naturel, mais aussi de son rôle dans la fondation de la civilisation et de la valeur de sa reconnaissance contre les mensonges conventionnels de la civilisation ; ces éléments d'argumentations – car, depuis Socrate, les gens sérieux ont tendance à justifier leurs affirmations – choquent, on ne comprend trop pourquoi, ceux qui pensent, à la manière stalinienne ou gauchiste, que la lutte politique - comprendre : les rapports de force - devrait désormais remplacer l'argumentation rationnelle et la connaissance -.
Dernière remarque : les dialogues I et surtout IV semblent traiter plutôt du souci des jeunes garçons (mais non, encore une fois, des petits garçons), donc de la pédérastie au sens grec du terme ; pédérastie qui n'est pas pédophilie, contrairement à une confusion trop fréquemment faite ; " Attracted to adolescent and prepubescent boys, Gide would today be called a pedophile " ; encore récemment par Jocelyn van Tuyl dans André Gide and the Second World War, Albany: State University of New York Press, 2006. L'UNESCO accepte actuellement la définition de la pédophilie comme une relation sexuelle avec un moins de 13 ans de la part de quelqu'un ayant au moins cinq ans de plus ; ce qui ne se trouve : 1) ni pratiqué dans la vie de Gide ; 2) ni évoqué dans ses œuvres de fiction ; 3) ni revendiqué dans Corydon. L'homosexualité en général, ou uranisme, est examinée dans les dialogues centraux (II et III). La description de Jocelyn van Tuyl " Corydon, a treatise in defense of homosexuality " (op. cit.) est donc réductrice (mais elle n'est pas à une confusion près...).
* * * * *
Œuvre rationaliste et critique, Corydon est dénuée de toute préoccupation politicienne, politique ou religieuse ; il n'y est fait aucune mention des interdits bibliques et en particulier des condamnations pauliniennes, on ne trouve même dans ces dialogues aucune trace de la crise mystique traversée par Gide en 1916. Cette laïcité justifie le rapprochement avec les passages de Montaigne sur la question et le très bel article de Voltaire, très beau compte-tenu des restrictions à la liberté d'expression de son temps (exemple de texte à lire aussi entre les lignes et dans le mouvement de sa pensée). Montaigne, Voltaire et Nietzsche, à la différence de l'Encyclopédie de Diderot, ne faisaient également aucune mention des condamnations bibliques.
Ce petit (par les dimensions) livre reste, par sa contribution documentée et intelligente à la cause de la " liberté en amour " (Cf Molière, Dom Juan, III, 5 : Dom Juan : « J’aime la liberté en amour. ») par le travail d’information et de réflexion qu'il nous propose, bien plus actuel que les productions LGBTQIA+ des années 1990-2020. " Il me répugne de citer les textes ", écrivait Paul Gide ; son fils André leur fait face et les commente, mais avec sobriété, sans user de toutes les flèches disponibles ; ainsi ne mentionne-t-il pas l'important Dialogue sur l'amour de Plutarque que son père avait évoqué avec déplaisir. Peut-on hasarder cette hypothèse ? Corydon réalise une ambition du post-Anciens André Gide, celle d'écrire un moderne Dialogue sur l'amour, que notre époque post-moderne ne sait plus apprécier.
Louis Le Sidaner, La Revue de l'Université, n°6, 15 août 1924 :
« Il a également fallu beaucoup de tact et de simplicité à M. André Gide pour écrire Corydon. Imaginez, cher lecteur, que c'est une défense et même un éloge de la pédérastie. Aussi brutalement résumée, la tentative de M. Gide paraît absurde, tout au moins paradoxale. Nous ne tenterons point de démontrer le contraire. Corydon est un de ces livres longuement médités, étudiés et rédigés avec soin, où chaque mot a sa raison et sa valeur et qu'il serait dangereux d'analyser en quelques lignes. Même l'admirateur le plus ardent des Civilisés de M. [Claude] Farrère [Paris : P. Ollendorff, 1906] serait probablement choqué de lire sans argumentation préalable le résumé brutal des conclusions de Corydon.
Et pourtant, tout esprit impartial et qui prendra la peine de regarder autour de lui, sinon dans ses propres souvenirs, sera bien obligé de convenir, après avoir lu le livre de M. André Gide, que la pédérastie est un phénomène normal et en tout cas naturel et nullement condamnable. Peut-être même suivra-t-il jusqu'au bout toutes les conclusions de Corydon.
Livre profond, d'une grande simplicité (quoique par instants un peu affectée ou énervée) et que ne vient jamais salir la vulgarité pornographique ou le désir " d'épater les bourgeois ", Corydon marquera une étape dans l'histoire littéraire des phénomènes sexuels et peut-être même de toute la philosophie. » (Repris dans BAAG, n° 74-75, avril-juillet 1987)
Ces dialogues furent bien plus, me semble-t-il, que ce qu'en disait, ironiquement, Paul Valéry : « Drôle d'idée chez Gide de faire de la liberté de la pédérastie un avenant à la déclaration des Droits de l'homme! Par ailleurs, ce goût est anti-finaliste. C'est un tropisme!! » (Cahiers XIV, octobre 1930).
. La suite, laïcisation de la société intégrant la contraception, la suppression du délit d’adultère, et même l’avortement, justifia l'entreprise de Gide, et donna tort à Roger Martin du Gard qui disait ne voir aucune possibilité de progrès. L'auteur des Thibault écrivit : « En fait, l'homosexualité reste justiciable de la même réprobation qu'autrefois, et se heurte, non seulement auprès de la plupart des moralistes, mais auprès de l'immense majorité des Français, aux mêmes flétrissures, aux mêmes condamnations sans appel. » (Notes sur André Gide, Paris : Gallimard, 1951).
À l’inverse, Jean-Paul Sartre, qui se trompa si souvent, fut, pour une fois, lucide : « Écrit par un étourdi, Corydon se fût réduit à une affaire de mœurs ; mais si l’auteur en est ce rusé Chinois qui pèse tout, le livre devient un manifeste, un témoignage, dont la portée dépasse de loin le scandale qu’il provoque. Cette audace précautionneuse devrait être une " Règle pour la direction de l’esprit " [Allusion au titre d’un opuscule de Descartes, Regulae ad directionem ingenii] : retenir son jugement jusqu’à l’évidence et, lorsque la conviction est acquise, accepter de payer pour elle jusqu’au dernier sou. » (Les Temps Modernes, mars 1951).
Gide en arriva en 1946 à considérer Corydon comme « Le plus utile … Je ne dis pas : le plus réussi [de ses livres]. Sa forme même ne me satisfait plus guère aujourd’hui, ni cette façon d’esquiver le scandale et d’attaquer le problème par feinte procuration. C’est aussi que, dans ce temps, je n’étais pas assez sûr de moi-même : je savais que j’avais raison ; mais je ne savais pas à quel point … » (Journal, janvier 1946).Frank Lestringant : « La pédérastie, chez Gide, n’est ni un détail ni un accident. C’est une composante essentielle de sa vie et de son œuvre. Gide, à plusieurs reprises au cours de son existence, a déclaré qu’il avait deux passions : « La pédérastie et la religion. » Variante : « La pédérastie et la littérature. » Quel que soit le second terme, religion ou littérature, la religion comme inspiratrice de la littérature ou la littérature comme religion, il y a toujours, comme premier terme, la pédérastie. C’est une constante, et presque la constante de son action. C’est la pédérastie qui a poussé Gide à s’engager et même à envisager de sang-froid le martyre. Tel est le sens de Corydon, de tous ses livres celui auquel il tenait le plus, et qui sera sans cesse retravaillé, retouché et augmenté entre 1909 et 1924, date de sa diffusion publique. Entre tous les « motifs » de Gide, au sens que l’on a défini plus haut, la pédérastie a sans doute été le plus fort, le plus puissant, et jusqu’à son extrême vieillesse, le plus impérieux. » (Le Salon Littéraire, 2012)
« Dès le mois de décembre prochain paraîtront Les Corydon d'André Gide, ensemble de textes présentés par Alain Goulet. Avec notamment une reproduction de l'originel C. R. D. N. de 1911 que bien peu ont pu consulter [Je l'avais fait à la Réserve de l'ancienne B. N. de la rue de Richelieu]. Dans ce livre Alain Goulet recense les caractéristiques des cinq éditions du texte (dont la dernière a paru dans la Pléiade en 2009) et fait le recensement de la réception critique entre 1924 et 1926. Mais il verse aussi le contenu d'une enveloppe que lui avait remis Catherine Gide en 2009 : le « dossier Corydon » [Dossier que j'avais consulté chez Catherine Gide à Neuilly, tout comme l'autre dossier " chez Chapon ", à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet]. Parmi ces documents, les nombreuses lettres reçues par Gide après la lecture de Corydon. « Ce livre est le complément du texte paru dans la Pléiade en 2009 et montrera l'action extraordinaire de Corydon sur un milieu spécifique. Ça a sauvé des vies et ces lettres en témoignent », assure notre ami Alain Goulet. » (e-gide, novembre 2013)
NOTES
1. Oreste et Pylade n'étaient peut-être que de bons amis dans la fiction. Mais bien d'autres couples antiques, réels ceux-là, méritaient d'être évoqués, et Diogène Laërce ne s'en était pas privé : Archélaos d'Athènes et Isocrate ont été amants de Socrate, lui-même ensuite épris d'Alcibiade ; le premier couple de philosophes aurait été celui formé par Parménide et Zénon d'Elée. À Platon on attribua cinq aimés : Agathon, Alexis, Aster, Dion et Phèdre ; à Aristote, un seul, Hermias. On a évoqué l'amour d'Anacréon pour Critias et celui de Critias pour Euthydème. Polémon était épris de Xénocrate et de Cratès ; Crantor aimait Arcésilas qui aima Démétrios ; Zénon de Citium fut amoureux de Chrémonidès, etc.
2. Lettre d'André Gide à Georges Hérelle du 14 juillet 1934, d'après la transcription de Hérelle (Bibliothèque Municipale de Troyes, mss 3188, folio 359) :
« Quelles furent, en réalité, les mœurs du Moyen-Age ? La littérature nous instruit-elle suffisamment sur les mœurs de cette époque ? Cette littérature si tendre, si délicieuse, est très idéaliste et très artificielle; mais nous dit-elle la vérité ? Qu'y a-t-il derrière ce charmant décor? Les Laures et les Béatrices sont des créations poétiques. Où et comment se renseigner ?
Par exemple, quel était le rôle des pages, jeunes compagnons des chevaliers ? Ceux-ci faisaient profession d'amour mystique: on ne parle que de cet amour-là, c'est le seul qu'on mette en avant. Mais comment supposer que tous ces gaillards restassent chastes ? Et vers qui se portaient alors leurs désirs sensuels ? A voir combien, aujourd'hui, la réalité diffère de l'apparence et combien le revêtement des mœurs est mensonger, il est permis de penser que ce mensonge n'est point particulier à notre époque, et qu'il était encore plus épais dans les temps où l'opinion, plus sévère, contraignait à plus de dissimulation.
Il faudrait étudier ce problème, sans tenir compte de la littérature, dans les chroniques secrètes, dans les procès criminels, dans les documents relatifs aux cloîtres, etc. etc. »
APPENDICE
GIDE, 1948 : « Dans les Annales du Centre Universitaire Méditerranéen, grand plaisir à trouver le Cours sur l'Art et la Pensée de Platon, du Père Valensin. Il signe Auguste Valensin, car lui déplaît cette sorte d'isoloir que risque de faire sa soutane, dans ses rapports avec le public, avec autrui; et on lui sait grand gré de rester sur le plan humain le plus possible, de se mettre de plain-pied avec vous. Egalement gré d'aborder sans effarouchement certaines questions scabreuses. Il en parle fort bien, avec la décence que l'on pouvait attendre de sa soutane, et avec une sorte de hardiesse qu'on n'osait espérer.
Néanmoins il est amené à tricher un peu, sans le vouloir, sans le savoir. Car enfin cette chasteté triomphante qu'il propose n'était pas un idéal païen ; pas même selon Platon, semble-t-il (ou qu'exceptionnellement), lequel cherche avant tout le bien-être harmonieux de la Cité et, comme le dit Valensin : « Une seule fin règle tout : assurez de beaux types d'humanité. » De sorte que la question reste tout urgente, laquelle il escamote ; à laquelle il ne devrait pas se dérober : Cette surabondance de pollen qui gêne l'adolescent, va trouver à se dépenser comment ? Espère-t-il que l'abstinence la résorbera tout entière ? Il sait bien que non ; ou que très exceptionnellement ; et en vue de quel idéal de sainteté que seul le christianisme peut légitimer... C'est sur ce point précis que porte la tricherie : on escamote l'exigence de la chair, de l'exonération nécessaire des glandes, pour laquelle il n'y a que quelques solutions, passées sous silence et pour cause : masturbation ou éjaculations spontanées, durant le sommeil ; et avec quels rêves érotiques ? Ici Platon lui-même triche en sublimant tout cela, qui reste d'ordre tout réel, et matériel, et... pratique. Je soutiens que le bon ordre de la cité se trouve moins compromis par le contact recherché entre jeunes mâles, et tire moins à conséquence que lorsque la libido dirige aussitôt les désirs de ces adolescents vers l'autre sexe. Je ne puis croire que ces rapports d'adolescents tels que nous les propose l'Antiquité, soit entre eux, soit avec des aînés, restassent chastes, c'est-à-dire non accompagnés d'émissions libératrices ; et si Platon n'en parle pas, c'est par décence et parce que, la chose allant de soi, il devenait inutile et malséant d'en parler. Platon sait fort bien que, lorsque Socrate se dérobe aux offres et provocations d'Alcibiade, il propose une sorte d'idéal quasi paradoxal, qui prête à la fois à l'admiration et au sourire, parce qu'il n'est pas naturel et ne peut servir d'exemple qu'à de très rares. Il s'élève ainsi au-dessus de l'humanité, direz-vous ; en vue de quelle récompense mystique, ou satisfaction de l'orgueil ?
Et lorsque Valensin écrit : « La question est donc tranchée : Platon ne peut être annexé par les partisans du vice » (ce mot péjoratif comporte en lui-même déjà un jugement qui n'est pas de mise, car il n'y avait pas là vice, à proprement parler, aux yeux des contemporains de Platon) ; « il condamne les comportements de la Vénus vulgaire. Il les condamne autant qu'il approuve et encourage ceux de la Vénus céleste », il s'agit aussi bien des rapports hétérosexuels que des homosexuels. Il oppose (Platon) vertu et laisser-aller au plaisir, quel que soit celui-ci. »
Journal, 11 juin 1948.