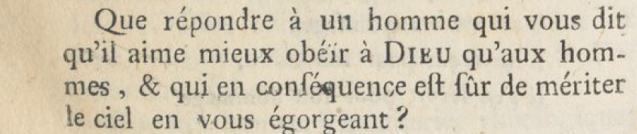Ceux qui diront que les temps de ces crimes sont passés ; qu’on ne verra plus de Barcochebas, de Mahomet, de Jean de Leyde, etc. ; que les flammes des guerres de religion sont éteintes, font, ce me semble, trop d’honneur à la nature humaine. Le même poison subsiste encore, quoique moins développé ; cette peste, qui semble étouffée, reproduit de temps en temps des germes capables d’infecter la terre. N’a-t-on pas vu de nos jours les prophètes des Cévennes tuer, au nom de Dieu, ceux de leur secte qui n’étaient pas assez soumis ?
[...]
Si la superstition ne se signale pas toujours par ces excès qui sont comptés dans l’histoire des crimes, elle fait dans la société tous les petits maux innombrables et journaliers qu’elle peut faire. Elle désunit les amis ; elle divise les parents ; elle persécute le sage, qui n’est qu’homme de bien, par la main du fou, qui est enthousiaste ; elle ne donne pas toujours de la ciguë à Socrate, mais elle bannit Descartes d’une ville qui devait être l’asile de la liberté ; elle donne à Jurieu, qui faisait le prophète, assez de crédit pour réduire à la pauvreté le savant et philosophe Bayle ; elle bannit, elle arrache à une florissante jeunesse qui court à ses leçons le successeur [Christian Wolff] du grand Leibnitz ; et il faut, pour le rétablir, que le ciel fasse naître un roi philosophe, vrai miracle qu’il fait bien rarement. En vain la raison humaine se perfectionne par la philosophie, qui fait tant de progrès en Europe ; en vain, vous surtout, grand prince, vous efforcez-vous de pratiquer et d’inspirer cette philosophie si humaine ; on voit dans ce même siècle, où la raison élève son trône d’un côté, le plus absurde fanatisme dresser encore ses autels de l’autre.
[...] M. le comte de Boulainvilliers écrivit, il y a quelques années, la Vie de ce prophète [La Vie de Mahomet, 1730]. Il essaya de le faire passer pour un grand homme que la providence avait choisi pour punir les chrétiens, et pour changer la face d’une partie du monde. M. Sale [George Sale, mort en 1736], qui nous a donné une excellente version de l’Alcoran en anglais, veut faire regarder Mahomet comme un Numa et comme un Thésée. J’avoue qu’il faudrait le respecter si, né prince légitime, ou appelé au gouvernement par le suffrage des siens, il avait donné des lois paisibles comme Numa, ou défendu ses compatriotes comme on le dit de Thésée. Mais qu’un marchand de chameaux excite une sédition dans sa bourgade ; qu’associé à quelques malheureux coracites [cailloux noirs] il leur persuade qu’il s’entretient avec l’ange Gabriel ; qu’il se vante d’avoir été ravi au Ciel, et d’y avoir reçu une partie de ce livre inintelligible [le Coran] qui fait frémir le sens commun à chaque page ; que, pour faire respecter ce livre, il porte dans sa patrie le fer et la flamme ; qu’il égorge les pères, qu’il ravisse les filles, qu’il donne aux vaincus le choix de sa religion ou de la mort, c’est assurément ce que nul homme ne peut excuser, à moins qu’il ne soit né Turc, et que la superstition n’étouffe en lui toute lumière naturelle.
Je sais que Mahomet n’a pas tramé précisément l’espèce de trahison qui fait le sujet de cette tragédie. L’histoire dit seulement qu’il enleva la femme de Séide, l’un de ses disciples, et qu’il persécuta Abusofian, que je nomme Zopire ; mais quiconque fait la guerre à son pays, et ose la faire au nom de Dieu, n’est-il pas capable de tout ? Je n’ai pas prétendu mettre seulement une action vraie sur la scène, mais des mœurs vraies ; faire penser les hommes comme ils pensent dans les circonstances où ils se trouvent, et représenter enfin ce que la fourberie peut inventer de plus atroce, et ce que le fanatisme peut exécuter de plus horrible. Mahomet n’est ici autre chose que Tartuffe les armes à la main.
[...] Pourquoi obéirais-je en aveugle à des aveugles qui me crient : Haïssez, persécutez, perdez celui qui est assez téméraire pour n’être pas de notre avis sur des choses même indifférentes que nous n’entendons pas ? Que ne puis-je servir à déraciner de tels sentiments chez les hommes ! L’esprit d’indulgence ferait des frères ; celui d’intolérance peut former des monstres.
C’est ainsi que pense Votre Majesté. Ce serait pour moi la plus grande des consolations de vivre auprès de ce roi philosophe. Mon attachement est égal à mes regrets ; et si d’autres devoirs m’entraînent, ils n’effaceront jamais de mon cœur les sentiments que je dois à ce prince qui pense et qui parle en homme ; qui fuit cette fausse gravité sous laquelle se cachent toujours la petitesse et l’ignorance ; qui se communique avec liberté, parce qu’il ne craint point d’être pénétré ; qui veut toujours s’instruire, et qui peut instruire les plus éclairés. »
1754-1757 :
SAINT-FOIX (1698-1776) : « Abdérame, lieutenant du calife de Damas, après avoir conquis l'Espagne, franchit les Pyrénées, s'avança jusqu'à Tours à la tête de quatre cent mille Sarrasins. Charles-Martel, par son activité, sa prudence et sa valeur, remporta la victoire la plus complète sur cette formidable armée, le 22 juillet 732 ; à peine, disent la plupart des historiens, en échappa-t-il vingt-cinq mille. Si ce vaillant homme n'avait pas arrêté cet impétueux torrent, on verrait peut-être aujourd'hui autant de turbans en France qu'en Asie ; quelle obligation ne lui avons-nous donc point ! » Essais historiques sur Paris et sur les Français, 1754-1757.
1756 : « Mahomet, comme tous les enthousiastes, violemment frappé de ses idées, les débita d’abord de bonne foi, les fortifia par des rêveries, se trompa lui-même en trompant les autres, et appuya enfin, par des fourberies nécessaires, une doctrine qu’il croyait bonne. » Voltaire,
Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, 1756, chapitre VI, "De l’Arabie et de Mahomet".
1756 : « Sa définition de Dieu est d’un genre plus véritablement sublime. On lui demandait quel était cet Allah qu’il annonçait : « C’est celui, répondit-il, qui tient l’être de soi-même, et de qui les autres le tiennent ; qui n’engendre point et qui n’est point engendré, et à qui rien n’est semblable dans toute l’étendue des êtres. » Cette fameuse réponse, consacrée dans tout l’Orient, se trouve presque mot à mot dans l’antépénultième chapitre du Koran.
[...]
Il n’y eut rien de nouveau dans la loi de Mahomet, sinon que Mahomet était prophète de Dieu.
En premier lieu, l’unité d’un être suprême, créateur et conservateur, était très ancienne. Les peines et les récompenses dans une autre vie, la croyance d’un paradis et d’un enfer, avaient été admises chez les Chinois, les Indiens, les Perses, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, et ensuite chez les Juifs, et surtout chez les chrétiens, dont la religion consacra cette doctrine.
L’Alcoran reconnaît des anges et des génies, et cette créance vient des anciens Perses. Celle d’une résurrection et d’un jugement dernier était visiblement puisée dans le Talmud et dans le christianisme. Les mille ans que Dieu emploiera, selon Mahomet, à juger les hommes, et la manière dont il y procédera, sont des accessoires qui n’empêchent pas que cette idée ne soit entièrement empruntée. Le pont aigu sur lequel les ressuscités passeront, et du haut duquel les réprouvés tomberont en enfer, est tiré de la doctrine allégorique des mages.
C’est chez ces mêmes mages, c’est dans leur
Jannat que Mahomet a pris l’idée d’un paradis, d’un jardin, où les hommes, revivant avec tous leurs sens perfectionnés, goûteront par ces sens mêmes toutes les voluptés qui leur sont propres, sans quoi ces sens leur seraient inutiles. C’est là qu’il a puisé l’idée de ces houris, de ces femmes célestes qui seront le partage des élus, et que les mages appelaient hourani, comme on le voit dans le Sadder. Il n’exclut point les femmes de son paradis, comme on le dit souvent parmi nous. Ce n’est qu’une raillerie sans fondement, telle que tous les peuples en font les uns des autres. Il promet des jardins, c’est le nom du paradis ; mais il promet pour souveraine béatitude la vision, la communication de l’Être suprême.
Le dogme de la prédestination absolue, et de la fatalité, qui semble aujourd’hui caractériser le mahométisme, était l’opinion de toute l’Antiquité : elle n’est pas moins claire dans l’Iliade que dans l’Alcoran.
À l’égard des ordonnances légales, comme la circoncision, les ablutions, les prières, le pèlerinage de la Mecque, Mahomet ne fit que se conformer, pour le fond, aux usages reçus. La circoncision était pratiquée de temps immémorial chez les Arabes, chez les anciens Égyptiens, chez les peuples de la Colchide, et chez les Hébreux. Les ablutions furent toujours recommandées dans l’Orient comme un symbole de la pureté de l’âme.
Point de religion sans prières. La loi que Mahomet porta, de prier cinq fois par jour, était gênante, et cette gêne même fut respectable. Qui aurait osé se plaindre que la créature soit obligée d’adorer cinq fois par jour son créateur ?
Quant au pèlerinage de la Mecque, aux cérémonies pratiquées dans le Kaaba et sur la pierre noire, peu de personnes ignorent que cette dévotion était chère aux Arabes depuis un grand nombre de siècles. Le Kaaba passait pour le plus ancien temple du monde ; et, quoiqu’on y vénérât alors trois cents idoles, il était principalement sanctifié par la pierre noire, qu’on disait être le tombeau d’Ismaël. Loin d’abolir ce pèlerinage, Mahomet, pour se concilier les Arabes, en fit un précepte positif.
Le jeûne était établi chez plusieurs peuples, et chez les Juifs, et chez les chrétiens. Mahomet le rendit très sévère, en l’étendant à un mois lunaire, pendant lequel il n’est pas permis de boire un verre d’eau, ni de fumer, avant le coucher du soleil ; et ce mois lunaire, arrivant souvent au plus fort de l’été, le jeûne devint par là d’une si grande rigueur qu’on a été obligé d’y apporter des adoucissements, surtout à la guerre.
Il n’y a point de religion dans laquelle on n’ait recommandé l’aumône. La mahométane est la seule qui en ait fait un précepte légal, positif, indispensable. L’Alcoran ordonne de donner deux et demi pour cent de son revenu, soit en argent, soit en denrées.
On voit évidemment que toutes les religions ont emprunté tous leurs dogmes et tous leurs rites les unes des autres.
Dans toutes ces ordonnances positives, vous ne trouverez rien qui ne soit consacré par les usages les plus antiques. Parmi les préceptes négatifs, c’est-à-dire ceux qui ordonnent de s’abstenir, vous ne trouverez que la défense générale à toute une nation de boire du vin, qui soit nouvelle et particulière au mahométisme. Cette abstinence, dont les musulmans se plaignent, et se dispensent souvent dans les climats froids, fut ordonnée dans un climat brillant, où le vin altérait trop aisément la santé et la raison. Mais, d’ailleurs, il n’était pas nouveau que des hommes voués au service de la Divinité se fussent abstenus de cette liqueur. Plusieurs collèges de prêtres en Égypte, en Syrie, aux Indes, les nazaréens, les récabites, chez les Juifs, s’étaient imposé cette mortification.
Elle ne fut point révoltante pour les Arabes : Mahomet ne prévoyait pas qu’elle deviendrait un jour presque insupportable à ses musulmans dans la Thrace, la Macédoine, la Bosnie, et la Servie. Il ne savait pas que les Arabes viendraient un jour jusqu’au milieu de la France, et les Turcs mahométans devant les bastions de Vienne.
Il en est de même de la défense de manger du porc, du sang, et des bêtes mortes de maladies ; ce sont des préceptes de santé : le porc surtout est une nourriture très-dangereuse dans ces climats, aussi bien que dans la Palestine, qui en est voisine. Quand le mahométisme s’est étendu dans les pays plus froids, l’abstinence a cessé d’être raisonnable, et n’a pas cessé de subsister.
La prohibition de tous les jeux de hasard est peut-être la seule loi dont on ne puisse trouver d’exemple dans aucune religion. Elle ressemble à une loi de couvent plutôt qu’à une loi générale d’une nation. Il semble que Mahomet n’ait formé un peuple que pour prier, pour peupler, et pour combattre.
Toutes ces lois qui, à la polygamie près, sont si austères, et sa doctrine qui est si simple, attirèrent bientôt à sa religion le respect et la confiance. Le dogme surtout de l’unité d’un Dieu, présenté sans mystère, et proportionné à l’intelligence humaine, rangea sous sa loi une foule de nations, et jusqu’à des nègres dans l’Afrique, et à des insulaires dans l’Océan indien.
Bornons-nous toujours à cette vérité historique : le législateur des musulmans, homme puissant et terrible, établit ses dogmes par son courage et par ses armes ; cependant sa religion devint indulgente et tolérante. L’instituteur divin du christianisme, vivant dans l’humilité et dans la paix, prêcha le pardon des outrages ; et sa sainte et douce religion est devenue, par nos fureurs, la plus intolérante de toutes, et la plus barbare. »
1756 : " Comment dans ce temps-là même les mahométans, qui, sous
Abdérame, vers l’an 734, subjuguèrent la moitié de la France, auraient-ils laissé subsister derrière les Pyrénées ce royaume des Asturies ? C’était beaucoup pour les chrétiens de pouvoir se réfugier dans ces montagnes et d’y vivre de leurs courses, en payant tribut aux mahométans. Ce ne fut que vers l’an 759 que les chrétiens commencèrent à tenir tête à leurs vainqueurs, affaiblis par les victoires de Charles Martel et par leurs divisions ; mais eux-mêmes, plus divisés entre eux que les mahométans, retombèrent bientôt sous le joug.
Mauregat, à qui il a plu aux historiens de donner le titre de roi, eut la permission de gouverner les Asturies et quelques terres voisines, en rendant hommage et en payant tribut. Il se soumit surtout à fournir cent belles filles tous les ans pour le sérail d’Abdérame. Ce fut longtemps la coutume des Arabes d’exiger de pareils tributs ; et aujourd’hui les caravanes, dans les présents qu’elles font aux Arabes du désert, offrent toujours des filles nubiles."
1759 : " Les captifs, mes compagnons, ceux qui les avaient pris, soldats, matelots, noirs, basanés, blancs, mulâtres, et enfin mon capitaine, tout fut tué, et je demeurai mourante sur un tas de morts. Des scènes pareilles se passaient, comme on sait, dans l’étendue de plus de trois cents lieues, sans qu’on manquât aux cinq prières par jour ordonnées par Mahomet. " (Voltaire,
Candide (1759), chapitre XI)
1762 JJ ROUSSEAU
" Mahomet eut des vues très saines ; il lia bien son système politique, et tant que la forme de son gouvernement subsista sous les califes ses successeurs, ce gouvernement fut exactement un, et bon en cela. Mais les Arabes, devenus florissants, lettrés, polis, mous et lâches, furent subjugués par des barbares ; alors la division entre les deux puissances [politique et religieuse] recommença ; quoiqu’elle soit moins apparente chez les mahométans que chez les chrétiens, elle y est pourtant, surtout dans la secte d’Ali ; et il y a des États, tels que la Perse, où elle ne cesse de se faire sentir. " (Jean-Jacques Rousseau,
Du Contrat social, IV, viii, 1762)
1765 : Chevalier Louis de Jaucourt (1704-1779),
« MAHOMÉTISME, s. m. (
Hist. des religions du monde.) religion de Mahomet. L'historien philosophe de nos jours [Voltaire] en a peint le tableau si parfaitement, que ce serait s'y mal connaître que d'en présenter un autre aux lecteurs.
Pour se faire, dit-il, une idée du
Mahométisme, qui a donné une nouvelle forme à tant d'empires, il faut d'abord se rappeler que ce fut sur la fin du sixième siècle, en 570, que naquit Mahomet à la Mecque dans l'
Arabie Pétrée. Son pays défendait alors sa liberté contre les Perses, et contre ces princes de Constantinople qui retenaient toujours le nom d'empereurs romains.
Les enfants du grand Noushirvan, indignes d'un tel père, désolaient la Perse par des guerres civiles et par des parricides. Les successeurs de Justinien avilissaient le nom de l'empire ; Maurice venait d'être détrôné par les armes de Phocas et par les intrigues du patriarche syriaque et de quelques évêques, que Phocas punit ensuite de l'avoir servi. Le sang de Maurice et de ses cins fils avait coulé sous la main du bourreau, et le pape Grégoire le grand, ennemis des patriarches de Constantinople, tâchaient d'attirer le tyran Phocas dans son parti, en lui proposant des louanges et en condamnant la mémoire de Maurice qu'il avait loué pendant sa vie. [...] Après avoir connu le caractère de ses concitoyens, leur ignorance, leur crédulité, et leur disposition à l'enthousiasme, il vit qu'il pouvait s'ériger en prophète, il feignit des révélations, il parla : il se fit croire d'abord dans sa maison, ce qui était probablement le plus difficile. [...]
Il enseignait aux Arabes, adorateurs des étoiles, qu'il ne fallait adorer que le Dieu qui les a faites, que les livres des Juifs et des Chrétiens s'étant corrompus et falsifiés, on devait les avoir en horreur : qu'on était obligé sous peine de châtiment éternel de prier cinq fois par jour, de donner l'aumône, et surtout, en ne reconnaissant qu'un seul Dieu, de croire en Mahomet son dernier prophète ; enfin de hasarder sa vie pour sa foi. [...]
Sa religion était d'ailleurs plus assujettissante qu'aucune autre, par les cérémonies légales, par le nombre et la forme des prières et des ablutions, rien n'étant plus gênant pour la nature humaine que des pratiques qu'elle ne demande pas et qu'il faut renouveler tous les jours.
Il proposait pour récompense une vie éternelle, où l'âme ferait enivrée de tous les plaisirs spirituels, le où le corps ressuscité avec ses sens, goûterait par ses sens mêmes toutes les voluptés qui lui font propres.,
Cette religion s'appela l'islamisme qui signifie résignation à la volonté de Dieu. Le livre qui la contient s'appela coran, c'est-à-dire, le livre, ou l'écriture, ou la lecture par excellence. [...]
On y voit surtout une ignorance profonde de la Physique la plus simple et la plus connue. C'est là la pierre de touche des livres que les fausses religions prétendent écrits par la Divinité. [...]
Le nouveau prophète donnait le choix à ceux qu'il voulait subjuguer d'embrasser sa secte ou de payer un tribut. [...] De tous les législateurs qui ont fondé des religions, il est le seul qui ait étendu la sienne par les conquêtes. [...]
Le peuple hébreux avait en horreur les autres nations, et craignait toujours d'être asservi. Le peuple arabe au contraire voulut tout attirer à lui, et se crut fait pour dominer. »
1765 : Denis DIDEROT (1713-1784),
« SARRASINS ou ARABES, philosophie des, : Le saint prophète ne savait ni lire ni écrire : de-là la haine des premiers musulmans contre toute espèce de connaissance ; le mépris qui s'en est perpétué chez leurs successeurs ; et la plus longue durée garantie aux mensonges religieux dont ils sont entêtés.
Mahomet fut si convaincu de l'incompatibilité de la Philosophie et de la Religion, qu'il décerna peine de mort contre celui qui s'appliquerait aux arts libéraux : c'est le même pressentiment dans tous les temps et chez tous les peuples, qui a fait hasarder de décrier la raison.
Le peu de lumière qui restait s'affaiblit au milieu du tumulte des armes, et s'éteignit au sein de la volupté ; l'alcoran fut le seul livre ; on brûla les autres, ou parce qu'ils étaient superflus s'ils ne contenaient que ce qui est dans l'alcoran, ou parce qu'ils étaient pernicieux, s'ils contenaient quelque chose qui n'y fût pas. Ce fut le raisonnement d'après lequel un des généraux ''sarrazins'' fit chauffer pendant six mois les bains publics avec les précieux manuscrits de la bibliothèque d'Alexandrie. On peut regarder Mahomet comme le plus grand ennemi que la raison humaine ait eu. Il y avait un siècle que sa religion était établie, et que ce furieux imposteur n'était plus, lorsqu'on entendait des hommes remplis de son esprit s'écrier que Dieu punirait le calife Almamon [Al-Ma’mūn calife de Bagdad de 813 à 833], pour avoir appelé les sciences dans ses États; au détriment de la sainte ignorance des fidèles croyants. »
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, tome 14 (1765), page 664, Neufchastel : Samuel Faulche et Compagnie.
1770 : VOLTAIRE :
« Ce livre gouverne despotiquement toute l’Afrique septentrionale, du mont Atlas au désert de Barca, toute l’Égypte, les côtes de l’Océan éthiopien dans l’espace de six cents lieues, la Syrie, l’Asie Mineure, tous les pays qui entourent la mer Noire et la mer Caspienne, excepté le royaume d’Astracan, tout l’empire de l’Indoustan, toute la Perse, une grande partie de la Tartarie, et dans notre Europe la Thrace, la Macédoine, la Bulgarie, la Servie, la Bosnie, toute la Grèce, l’Épire, et presque toutes les îles jusqu’au petit détroit d’Otrante, où finissent toutes ces immenses possessions. [...] Cet Alcoran dont nous parlons est un recueil de révélations ridicules et de prédications vagues et incohérentes, mais de lois très bonnes pour le pays où il vivait, et qui sont toutes encore suivies sans avoir jamais été affaiblies ou changées par des interprètes mahométans, ni par des décrets nouveaux. »
« Il était bien difficile qu'une religion si simple et si sage, enseignée par un homme toujours victorieux, ne subjuguât pas une partie de la Terre. En effet les musulmans ont fait autant de prosélytes par la parole que par l'épée. Ils ont converti à leur religion les Indiens et jusqu'aux nègres. Les Turcs même leurs vainqueurs se sont soumis à l'islamisme. [...] Il défendit le vin, parce qu’un jour quelques-uns de ses sectateurs arrivèrent à la prière étant ivres. Il permit la pluralité des femmes, se conformant en ce point à l’usage immémorial des Orientaux. En un mot, ses lois civiles sont bonnes ; son dogme est admirable en ce qu’il a de conforme avec le nôtre ; mais les moyens sont affreux : c’est la fourberie et le meurtre. [...] Les premiers musulmans furent animés par Mahomet de la rage de l'enthousiasme. Rien n'est plus terrible qu'un peuple qui, n'ayant rien à perdre, combat à la fois par esprit de rapine et de religion. [...]
Il disait que « la jouissance des femmes le rendait plus fervent à la prière ». En effet pourquoi ne pas dire benedicite et grâces au lit comme à table ? une belle femme vaut bien un souper. On prétend encore qu’il était un grand médecin ; ainsi il ne lui manqua rien pour tromper les hommes. »
Questions sur l'Encyclopédie, article "Alcoran, ou plutôt le Koran", section II.
« Nous convenons avec Grotius que les mahométans ont prodigué des rêveries. Un homme qui recevait continuellement les chapitres de son Koran des mains de l’ange Gabriel était pis qu’un rêveur : c’était un imposteur, qui soutenait ses séductions par son courage. Mais certainement il n’y avait rien ni d’étourdi, ni de sale, à réduire au nombre de quatre le nombre indéterminé de femmes que les princes, les satrapes, les nababs, les omras de l’Orient, nourrissaient dans leurs sérails. Il est dit que Salomon avait sept cents femmes et trois cents concubines. »
1771
Article " Fanatisme ", section première.
1774
Je vous le dis encore, ignorants imbéciles, à qui d’autres ignorants ont fait accroire que la religion mahométane est voluptueuse et sensuelle, il n’en est rien [Voyez
Essai sur les Mœurs, chapitre vii, tome XI, page 216 ; et dans les
Mélanges, année 1767, le chapitre iii de la
Défense de mon oncle.] ; on vous a trompés sur ce point comme sur tant d’autres.
Chanoines, moines, curés même, si on vous imposait la loi de ne manger ni boire depuis quatre heures du matin jusqu’à dix du soir, pendant le mois de juillet, lorsque le carême arriverait dans ce temps ; si on vous défendait de jouer à aucun jeu de hasard sous peine de damnation ; si le vin vous était interdit sous la même peine ; s’il vous fallait faire un pèlerinage dans des déserts brûlants ; s’il vous était enjoint de donner au moins deux et demi pour cent de votre revenu aux pauvres ; si, accoutumés à jouir de dix-huit femmes, on vous en retranchait tout d’un coup quatorze ; en bonne foi, oseriez-vous appelez cette religion sensuelle ?
Les chrétiens latins ont tant d’avantages sur les musulmans, je ne dis pas en fait de guerre, mais en fait de doctrine ; les chrétiens grecs les ont tant battus en dernier lieu depuis 1769 jusqu’en 1773, que ce n’est pas la peine de se répandre en reproches injustes sur l’islamisme.
Tâchez de reprendre sur les mahométans tout ce qu’ils ont envahi ; mais il est plus aisé de les calomnier.
Je hais tant la calomnie que je ne veux pas même qu’on impute des sottises aux Turcs, quoique je les déteste comme tyrans des femmes et ennemis des arts.
Je ne sais pourquoi l’historien du Bas-Empire prétend [Douzième volume, page 209. (Note de Voltaire.)] que Mahomet parle dans son Koran de son voyage dans le ciel ; Mahomet n’en dit pas un mot, nous l’avons prouvé [Voyez " Arot et Marot " ; et dans les
Mélanges, année 1750, le
Remerciement sincère à un homme charitable ; et, année 1767, le chapitre xii de l’
Examen important de milord Bolingbroke].
Il faut combattre sans cesse. Quand on a détruit une erreur, il se trouve toujours quelqu’un qui la ressuscite [Voyez Arot et Marot, et Alcoran. (Note de Voltaire)] " (
Questions sur l'Encyclopédie,
article "Mahométans")
« Votre religion [celle du mufti de Constantinople], quoiqu’elle ait de bonnes choses, comme l’adoration du grand Être, et la nécessité d’être juste et charitable, n’est d’ailleurs qu’un réchauffé du judaïsme, et un ramas ennuyeux de contes de ma mère-l’oie. Si l’archange Gabriel avait apporté de quelque planète les feuilles du Koran à Mahomet, toute l’Arabie aurait vu descendre Gabriel ; personne ne l’a vu : donc Mahomet n’était qu’un imposteur hardi qui trompa des imbéciles. »
(Questions sur l'Encyclopédie, article " Raison ".)
« Voudrais-tu que j'adoptasse les rêveries de Confucius, plutôt que les absurdités de Brahma, adorerais-je le grand serpent des nègres, l'astre des Péruviens ou le dieu des armées de Moïse, à laquelle des sectes de Mahomet voudrais-tu que je me rendisse, ou quelle hérésie de chrétiens serait selon toi préférable ? [...] Reviens à la raison, prédicant, ton Jésus ne vaut pas mieux que Mahomet, Mahomet pas mieux que Moïse, et tous trois pas mieux que Confucius qui pourtant dicta quelques bons principes pendant que les trois autres déraisonnaient; mais en général tous ces gens-là ne sont que des imposteurs, dont le philosophe s'est moqué, que la canaille a crus et que la justice aurait dû faire pendre. »
1784 : Caron de Beaumarchais :
« Je me jette à corps perdu dans le théâtre ; me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail ; auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule : à l’instant un envoyé … de je ne sais où se plaint que j’offense dans mes vers la Sublime Porte [les Turcs], la Perse, une partie de la presqu’île de l’Inde, toute l’Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d’Alger et de Maroc : et voilà ma comédie flambée, pour plaire aux princes mahométans, dont pas un, je crois, ne sait lire, et qui nous meurtrissent l’omoplate, en nous disant : « chiens de chrétiens » ! Ne pouvant avilir l’esprit, on se venge en le maltraitant. »
Le Mariage de Figaro (1784), V, iii.
1794 : Marquis de CONDORCET (1743-1794 ) :
« À Constantinople même le despotisme militaire des sultans a été forcé de plier devant le crédit des interprètes privilégiés des lois de l'alcoran. » (Cinq mémoires sur l’instruction publique (1791), Premier mémoire " Nature et objet de l’instruction publique ").
« J'exposerai comment la religion de Mahomet, la plus simple dans ses dogmes, la moins absurde dans ses pratiques, la plus tolérante dans ses principes, semble condamner à un esclavage éternel, à une incurable stupidité, toute cette vaste portion de la Terre où elle a étendu son empire ; tandis que nous allons voir briller le génie des sciences et de la liberté sous les superstitions les plus absurdes, au milieu de la plus barbare intolérance. La Chine nous offre le même phénomène, quoique les effets de ce poison abrutissant y aient été moins funestes. »
« Frédéric II fut soupçonné d’être ce que nos prêtres du XVIIIe siècle ont depuis appelé un
Philosophe. Le pape l’accusa, devant toutes les nations, d’avoir traité de fables politiques les religions de Moïse, de Jésus et de Mahomet. On attribuait à son chancelier, Pierre Des Vignes, le livre imaginaire des
Trois Imposteurs. Mais le titre seul annonçait l’existence d’une opinion, résultat bien naturel de l’examen de ces trois croyances, qui, nées de la même source, n’étaient que la corruption d’un culte plus pur, rendu, par des peuples plus anciens à l’âme universelle du monde. »
Esquisse...
, " Septième époque : Depuis les premiers progrès des sciences, lors de leur restauration dans l’Occident, jusqu’à l’invention de l’imprimerie. "